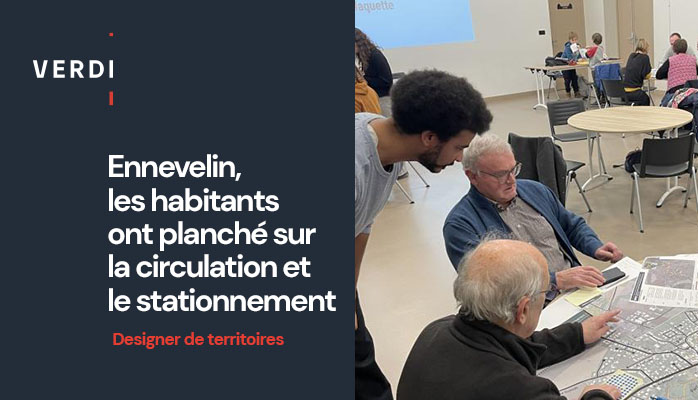
La Voix du Nord | 11.02.2025
Ennevelin, les habitants
ont planché sur la circulation et le stationnement
ont planché sur la circulation et le stationnement
Jeudi 6 février, une trentaine d'habitants se sont retrouvés lors d'une réunion à la médiathèque La Marque Page. Mission : mettre sur une carte leurs propositions pour la sécurité, la circulation et le stationnement.
VOIR PLUS
En septembre 2024, une déambulation avait été organisée pour identifier déjà des premiers points sensibles dans les rues du centre-bourg d’Ennevelin. “ L’idée était de revenir vers vous pour que vous vous exprimiez ”, a déclaré le maire, Michel Dupont, en accueillant les participants. Parallèlement, un questionnaire avait été mis en ligne, et 42 d’entre eux avaient été remplis et renvoyés, aussi par les Ennevelinois.

Le maire Michel Dupont a rappelé la volonté de la commune de donner la parole aux habitants
L’étude en cours est confiée aux techniciens urbanistes du cabinet Verdi, en parallèle de l’étude de cadre de vie qui, elle aussi, a été menée en mode interactif avec les habitants.

Le technicien de Verdi a précisé les enjeux de l’enquête
La vitesse, élément préoccupant
Thomas Garbin, du cabinet missionné, a rappelé les axes de l’étude autour du stationnement, des déplacements routiers, piétons et cyclables, avant d’expliquer les règles du jeu : sur chacune des tables, un grand plan d’Ennevelin, un sachet contenant panneaux de circulation routière, aménagements comme des passages piétons, dos d’ânes et autres, et des post-it pour ajouter idées, propositions et remarques. Le but étant d’aménager idéalement les rues en 50 minutes.

Thomas Garbin, du cabinet Verdi, explique aux habitants leurs missions
Au premier rang des préoccupations, la vitesse revenait souvent parmi les discussions, qu’elle soit celle des véhicules légers, des poids lourds ou des bus. Ici, deux mères de famille font remarquer que les passages piétons ne sont pas suffisamment visibles. “ Et si on mettait une couleur de revêtement différent ? ”, propose l’une d’elles, “ ou un éclairage bleuté ”, propose un autre habitant.
Aménagements cyclables et stationnement
Les cheminements à vélo sécurisés sont souhaités avec pourquoi pas un chaucidou sécurisant. Des passages surélevés, pourquoi pas ? Mais ça fait du bruit pour les riverains voisins. Les habitants ont pu confronter leurs avis parfois contraires, ce qu’ils ont apprécié. Le stationnement a aussi été l’objet de partages : à conforter, à sécuriser, à optimiser, et régulariser a précisé le technicien.
Au final, les propositions ont été nombreuses. À partir des éléments recueillis, charge est donnée au cabinet Verdi de faire une proposition à la municipalité qui, une fois validée, fera l’objet d’une présentation publique avant l’été prochain.

Le maire Michel Dupont a rappelé la volonté de la commune de donner la parole aux habitants
L’étude en cours est confiée aux techniciens urbanistes du cabinet Verdi, en parallèle de l’étude de cadre de vie qui, elle aussi, a été menée en mode interactif avec les habitants.

Le technicien de Verdi a précisé les enjeux de l’enquête
La vitesse, élément préoccupant
Thomas Garbin, du cabinet missionné, a rappelé les axes de l’étude autour du stationnement, des déplacements routiers, piétons et cyclables, avant d’expliquer les règles du jeu : sur chacune des tables, un grand plan d’Ennevelin, un sachet contenant panneaux de circulation routière, aménagements comme des passages piétons, dos d’ânes et autres, et des post-it pour ajouter idées, propositions et remarques. Le but étant d’aménager idéalement les rues en 50 minutes.

Thomas Garbin, du cabinet Verdi, explique aux habitants leurs missions
Au premier rang des préoccupations, la vitesse revenait souvent parmi les discussions, qu’elle soit celle des véhicules légers, des poids lourds ou des bus. Ici, deux mères de famille font remarquer que les passages piétons ne sont pas suffisamment visibles. “ Et si on mettait une couleur de revêtement différent ? ”, propose l’une d’elles, “ ou un éclairage bleuté ”, propose un autre habitant.
Aménagements cyclables et stationnement
Les cheminements à vélo sécurisés sont souhaités avec pourquoi pas un chaucidou sécurisant. Des passages surélevés, pourquoi pas ? Mais ça fait du bruit pour les riverains voisins. Les habitants ont pu confronter leurs avis parfois contraires, ce qu’ils ont apprécié. Le stationnement a aussi été l’objet de partages : à conforter, à sécuriser, à optimiser, et régulariser a précisé le technicien.
Au final, les propositions ont été nombreuses. À partir des éléments recueillis, charge est donnée au cabinet Verdi de faire une proposition à la municipalité qui, une fois validée, fera l’objet d’une présentation publique avant l’été prochain.

Le Moniteur | 31.01.2025
La ZAC Andromède
aborde son dernier round
aborde son dernier round
Andromède est un écoquartier aménagé, qui accueille toutes les fonctions de la ville et de nombreux espaces verts. Aujourd'hui, il accueille plus de 6 500 habitants, 18 commerces sont déjà ouverts et 80 000 m² de bureaux sont livrés.
VOIR PLUS
La dernière phase d'aménagement de la ZAC Andromède, créée en 2001, avance avec l'achèvement de la concertation en fin d'année 2024. Situé au cœur de la métropole toulousaine, à cheval sur les communes de Blagnac et Beauzelle (Haute-Garonne), ce quartier de 210 ha a d'abord été confié à TGT (urbanistes), Woodstock Paysage et Egis. L'aménageur Oppidea, en partenariat avec la mairie de Blagnac, a choisi Devillers et Associés avec Verdi Ingénierie Sud-Ouest pour cette ultime étape centrée sur la préservation de l'environnement et le respect de la biodiversité. La ZAC compte à ce jour près de 4 000 logements livrés.
“ Cette troisième et dernière tranche est assise sur 57 ha, mais 16,5 ha ne seront pas aménagés et les 1 682 futurs logements n'occuperont que 26 % de la zone ”, détaille Bertrand de Larquier, directeur opérationnel d'Oppidea. Ce sont véritablement les espaces naturels qui caractérisent ce secteur : 8 ha d'espaces verts sont aménagés, 12,1h a au sud de la phase 3 sont conservés en l'état et 30,3 ha “ compensés ” à la frontière de la ZAC pour la cisticole des joncs, une espèce de chauve-souris, et le lézard à deux raies. A sa création, Andromède se voulait déjà pionnière sur le plan écologique. Elle a été labellisée EcoQuartier pour son architecture bioclimatique, la qualité environnementale de ses bâtiments, leur performance énergétique ainsi que la gestion des eaux pluviales à l'échelle du territoire.
Terres maraîchères.
“ Ce quartier s'inscrit dans l'air du temps grâce à la biodiversité qui s'y est installée, estime le maire (PRG) de Blagnac, Joseph Carles. Une biodiversité dont il a fallu encourager le développement. ” Cette contrainte a également bousculé les codes architecturaux et a conduit l'élu à accepter la présence de bâtiments plus hauts. Un immeuble de 14 étages sera ainsi construit sur la costière de la Garonne. “ Ses habitants auront une vue sur la plaine maraîchère, le fleuve et les Pyrénées. J'accepte les formes urbaines contemporaines, mais avec des espaces verts ”, précise-t-il. Les autres constructions ne dépasseront pas le niveau R + 5 avec attique.

Une partie de la phase 3 a déjà été réalisée par l'ancienne équipe de maîtrise d'œuvre avec la création d'un groupe scolaire.
Cette nouvelle phase qui s'engage est l'occasion de renouer avec la tradition maraîchère de la ville. “ Nous envisageons de transformer la ferme de Sauzas, une ancienne métairie rachetée par la municipalité en 2007, pour y installer la Maison de l'environnement ”, souligne le maire. Une démarche alignée avec la politique de la commune qui, après le rachat de 75 % des terres agricoles du secteur, installe des jeunes maraîchers gratuitement pendant quatre ans afin que le quartier renoue avec sa vocation originelle.
Plus sobre en espaces publics et en infrastructures, cette dernière phase a vu son coût évalué à 20 M€ (hors honoraires). Au total, la ZAC Andromède a mobilisé 80 M€ d'investissement. L'enquête publique est prévue en septembre prochain, le démarrage des travaux en 2027 et son achèvement en 2038.
“ Cette troisième et dernière tranche est assise sur 57 ha, mais 16,5 ha ne seront pas aménagés et les 1 682 futurs logements n'occuperont que 26 % de la zone ”, détaille Bertrand de Larquier, directeur opérationnel d'Oppidea. Ce sont véritablement les espaces naturels qui caractérisent ce secteur : 8 ha d'espaces verts sont aménagés, 12,1h a au sud de la phase 3 sont conservés en l'état et 30,3 ha “ compensés ” à la frontière de la ZAC pour la cisticole des joncs, une espèce de chauve-souris, et le lézard à deux raies. A sa création, Andromède se voulait déjà pionnière sur le plan écologique. Elle a été labellisée EcoQuartier pour son architecture bioclimatique, la qualité environnementale de ses bâtiments, leur performance énergétique ainsi que la gestion des eaux pluviales à l'échelle du territoire.
Terres maraîchères.
“ Ce quartier s'inscrit dans l'air du temps grâce à la biodiversité qui s'y est installée, estime le maire (PRG) de Blagnac, Joseph Carles. Une biodiversité dont il a fallu encourager le développement. ” Cette contrainte a également bousculé les codes architecturaux et a conduit l'élu à accepter la présence de bâtiments plus hauts. Un immeuble de 14 étages sera ainsi construit sur la costière de la Garonne. “ Ses habitants auront une vue sur la plaine maraîchère, le fleuve et les Pyrénées. J'accepte les formes urbaines contemporaines, mais avec des espaces verts ”, précise-t-il. Les autres constructions ne dépasseront pas le niveau R + 5 avec attique.

Une partie de la phase 3 a déjà été réalisée par l'ancienne équipe de maîtrise d'œuvre avec la création d'un groupe scolaire.
Cette nouvelle phase qui s'engage est l'occasion de renouer avec la tradition maraîchère de la ville. “ Nous envisageons de transformer la ferme de Sauzas, une ancienne métairie rachetée par la municipalité en 2007, pour y installer la Maison de l'environnement ”, souligne le maire. Une démarche alignée avec la politique de la commune qui, après le rachat de 75 % des terres agricoles du secteur, installe des jeunes maraîchers gratuitement pendant quatre ans afin que le quartier renoue avec sa vocation originelle.
Plus sobre en espaces publics et en infrastructures, cette dernière phase a vu son coût évalué à 20 M€ (hors honoraires). Au total, la ZAC Andromède a mobilisé 80 M€ d'investissement. L'enquête publique est prévue en septembre prochain, le démarrage des travaux en 2027 et son achèvement en 2038.

France 3 Hauts-de-France | 24.01.2025
Ham, en immersion
dans le château d'eau
dans le château d'eau
Prenez avec nous de la hauteur. Ne regardez surtout pas en bas si vous avez, ne serait-ce qu'un peu, le vertige. Laurent Compagnon vous emmène à plus de 40 m au-dessus du sol, dans le château d'eau d'Ham, dans la Somme, qu'il vient de rénover.
VOIR PLUS

Franceinfo : •3 Hauts-de-France | 20.01.2025
Les châteaux d'eau, des géants de béton indispensables
à la vie quotidienne
à la vie quotidienne
Ils sont partout : aux abords des villes comme au milieu des champs. De forme hélicoïdale, conique ou demi-sphérique. Décorés ou pas. Les châteaux d'eau sont des éléments architecturaux et techniques indispensables à notre vie quotidienne. Visite guidée de celui de Ham, dans la Somme, qui culmine à plus de 40 m de haut.
VOIR PLUS
Tout le monde passe régulièrement à proximité sans vraiment se poser de questions tant ils font partie du paysage. Il y en aurait plus de 16 000 en France. De toutes formes. De toutes couleurs. De toute hauteur. Plantés au milieu des campagnes ou à l'entrée des grandes villes, ces géants de béton assurent aux habitants un accès à l'eau courante. Mais qui sait comment fonctionne un château d'eau ? Depuis l'instauration du plan Vigipirate, ces points stratégiques de la vie quotidienne ne sont plus visitables au tout-venant.
Les premiers châteaux d'eau au début du XXe siècle
Alors venez avec nous. Prenez avec nous de la hauteur. Ne regardez surtout pas en bas si vous avez, ne serait-ce qu'un peu, le vertige. Parce qu'on vous emmène à plus de 40 m au-dessus du sol, dans le château d'eau de Ham dans la Somme.

Le château d'eau de Ham culmine à plus de 40 m de hauteur. © Philippe Gossin
Construit en 1972, ce cône inversé est l'un des derniers construits dans les Hauts-de-France. "Les plus vieux châteaux d’eau datent du début du XXᵉ siècle pour alimenter les grandes villes comme Amiens ou Saint-Quentin, précise Laurent Compagnon, maître d’œuvre du lieu et responsable d’activité eau potable chez Verdi Ingénierie. Les châteaux d’eau pour les plus petites communes et les campagnes ont été construits dans les années 50, après-guerre, voire les années 70 pour les plus récents."
Il assure l'alimentation en eau des 5 000 habitants de la commune et de quelques centaines de personnes des villages alentour. Il peut également dépanner la commune voisine d’Eppeville qui compte 2 000 habitants.

Le château d'eau de Ham alimente en eau courante plus de 5000 personnes. © Gaëlle Fauquembergue
En matière de châteaux d'eau, il n'y a pas de règle d'implantation : tout dépend de la densité de population. Blanc de la tête aux pieds, celui de Ham a été récemment rénové. "Ce n’est pas la première fois qu’il est refait à l’extérieur, mais là, on l’a refait à l’extérieur et à l’intérieur : l'étanchéité des deux bassins, la tuyauterie, l’installation électrique, explique Eric Legrand, maire (DVG) de Ham. On a rénové en même temps la station de pompage qui est à quelques kilomètres d’ici." Un gros chantier et une grosse facture : environ 600 000 € au total.
Une installation simple
Au rez-de-chaussée du château d'eau, deux gros tuyaux qui vont du sol vers le haut de l'édifice. L'un d'eux, le tuyau dit de refoulement, permet de remplir les cuves.

Il y a deux tuyaux dans un château d'eau : un de remplissage et un de distribution. © Gaëlle Fauquembergue
"L’eau arrive par le tuyau de refoulement directement depuis le captage qui est à quelques kilomètres d’ici. Le captage, c’est une nappe phréatique, nous montre Laurent Compagnon. C’est un trou dans lequel on a mis deux pompes pour prendre de l’eau. La pompe du captage envoie l’eau directement dans le tuyau de refoulement vers la cuve. Elle est dimensionnée pour pouvoir pousser le débit d’environ 180 m³ par heure. C’est une grosse pompe qui permet de remplir le château d’eau plusieurs fois par jour, durant la nuit, principalement pour des questions d’économies d’énergie. Une fois qu’elle est là-haut, elle redescend gravitairement dans le deuxième tuyau dit de distribution grâce à la pression de l’eau. La conduite de distribution qui permet de renvoyer l’eau directement dans le réseau de la ville chez les abonnés."
À côté des deux tuyaux, une sonde mesure en permanence le taux de chlore présent dans l'eau qui est désinfectée par prévention.

L'eau est désinfectée au chlore avant d'être distribuée dans les foyers. © Gaëlle Fauquembergue
Un autre petit appareil mesure en direct le débit en m³ par heure : "On pompe en moyenne entre 700 et 800 m³ par jour. La consommation augmente en général vers 18/20h et redescend avec la nuit. On suit le débit la nuit pour voir s’il y a des fuites sur le réseau", indique notre guide.
Une vue à 360°
Direction le palier intermédiaire du château d'eau, à 25 m au-dessus du sol. À Ham, nous avons de la chance : on emprunte un escalier en colimaçon pour accéder aux étages supérieurs. "Mais tous les châteaux d’eau n’ont pas d’escaliers. Certains ont encore des échelles droites", avoue Laurent Compagnon.

L'escalier en colimaçon qui monte au sommet du château d'eau de Ham. © Gaëlle Fauquembergue
On y retrouve le tuyau de refoulement, qui fait monter l'eau, et celui de distribution, qui la fait redescendre. Notre ascension se poursuit à 35 m de hauteur, jusqu'au ventre du château d'eau : les cuves de stockage de l'eau d'une capacité de 2 000 m³. "Il y en a deux pour faciliter l’exploitation, notamment les lavages annuels. Ça nous permet d’en avoir toujours une en service. Mais sinon, les deux fonctionnent en parallèle. Il y a des sondes qui mesurent en permanence le niveau de l’eau. Et quand le niveau atteint une certaine valeur, le captage reçoit l’ordre de démarrer les pompes et de remplir les cuves."

Au sommet du château d'eau de Ham, il y a deux cuves de 2000 m³. © Gaëlle Fauquembergue
La fin de notre périple nous emmène au grand air, sur le dôme du bâtiment, à 40 m de hauteur. Si la forme des châteaux d'eau est purement esthétique et doit seulement prévoir un sommet plus large que le pied, leur hauteur a une véritable importance : "l’intérêt d’être aussi haut, c’est la pression au robinet : plus le château d’eau est haut, plus on a de pression chez soi. Tous les châteaux d’eau ne sont pas aussi hauts. Ça dépend de la topographie de chaque commune. On choisit le point naturel le plus haut pour élever l’altimétrie. Un château d’eau, c’est toujours utile pour avoir de l’eau en tout temps et en tout lieu. En cas de coupure d’eau et d'électricité, ça permet de rester autonome. Ici, on peut tenir environ une journée sans électricité, mais avec de l’eau", explique Laurent Compagnon.
Un point privilégié pour la téléphonie mobile
Une hauteur qui intéresse également les opérateurs de téléphonie mobiles qui ont trouvé dans le sommet des châteaux d'eau des points privilégiés pour installer leurs antennes. "Ça leur évite de poser un pylône".

Le sommet des châteaux d'eau accueille souvent des antennes de téléphonie mobile. © Gaëlle Fauquembergue
On vous l'a dit : ne regardez pas en bas ! Admirez plutôt le paysage et cette vue panoramique à 360° : l'ancienne sucrerie d'Eppeville et ses silos et même la cathédrale de Saint-Quentin quand il fait beau.
Voilà. Vous savez maintenant comment fonctionne un château d'eau. Inutile donc de s'attarder tout là-haut. Reprenons le petit escalier en colimaçon. Redescendons sur le plancher des vaches. Sachez enfin que le plus haut château de France, 93 m, se trouve à Férel dans le Morbihan. Celui de Marcq-en-Barœul, avec ses 83 m de haut, est le plus des Hauts-de-France.
Les premiers châteaux d'eau au début du XXe siècle
Alors venez avec nous. Prenez avec nous de la hauteur. Ne regardez surtout pas en bas si vous avez, ne serait-ce qu'un peu, le vertige. Parce qu'on vous emmène à plus de 40 m au-dessus du sol, dans le château d'eau de Ham dans la Somme.

Le château d'eau de Ham culmine à plus de 40 m de hauteur. © Philippe Gossin
Construit en 1972, ce cône inversé est l'un des derniers construits dans les Hauts-de-France. "Les plus vieux châteaux d’eau datent du début du XXᵉ siècle pour alimenter les grandes villes comme Amiens ou Saint-Quentin, précise Laurent Compagnon, maître d’œuvre du lieu et responsable d’activité eau potable chez Verdi Ingénierie. Les châteaux d’eau pour les plus petites communes et les campagnes ont été construits dans les années 50, après-guerre, voire les années 70 pour les plus récents."
Il assure l'alimentation en eau des 5 000 habitants de la commune et de quelques centaines de personnes des villages alentour. Il peut également dépanner la commune voisine d’Eppeville qui compte 2 000 habitants.

Le château d'eau de Ham alimente en eau courante plus de 5000 personnes. © Gaëlle Fauquembergue
En matière de châteaux d'eau, il n'y a pas de règle d'implantation : tout dépend de la densité de population. Blanc de la tête aux pieds, celui de Ham a été récemment rénové. "Ce n’est pas la première fois qu’il est refait à l’extérieur, mais là, on l’a refait à l’extérieur et à l’intérieur : l'étanchéité des deux bassins, la tuyauterie, l’installation électrique, explique Eric Legrand, maire (DVG) de Ham. On a rénové en même temps la station de pompage qui est à quelques kilomètres d’ici." Un gros chantier et une grosse facture : environ 600 000 € au total.
Une installation simple
Au rez-de-chaussée du château d'eau, deux gros tuyaux qui vont du sol vers le haut de l'édifice. L'un d'eux, le tuyau dit de refoulement, permet de remplir les cuves.

Il y a deux tuyaux dans un château d'eau : un de remplissage et un de distribution. © Gaëlle Fauquembergue
"L’eau arrive par le tuyau de refoulement directement depuis le captage qui est à quelques kilomètres d’ici. Le captage, c’est une nappe phréatique, nous montre Laurent Compagnon. C’est un trou dans lequel on a mis deux pompes pour prendre de l’eau. La pompe du captage envoie l’eau directement dans le tuyau de refoulement vers la cuve. Elle est dimensionnée pour pouvoir pousser le débit d’environ 180 m³ par heure. C’est une grosse pompe qui permet de remplir le château d’eau plusieurs fois par jour, durant la nuit, principalement pour des questions d’économies d’énergie. Une fois qu’elle est là-haut, elle redescend gravitairement dans le deuxième tuyau dit de distribution grâce à la pression de l’eau. La conduite de distribution qui permet de renvoyer l’eau directement dans le réseau de la ville chez les abonnés."
À côté des deux tuyaux, une sonde mesure en permanence le taux de chlore présent dans l'eau qui est désinfectée par prévention.

L'eau est désinfectée au chlore avant d'être distribuée dans les foyers. © Gaëlle Fauquembergue
Un autre petit appareil mesure en direct le débit en m³ par heure : "On pompe en moyenne entre 700 et 800 m³ par jour. La consommation augmente en général vers 18/20h et redescend avec la nuit. On suit le débit la nuit pour voir s’il y a des fuites sur le réseau", indique notre guide.
Une vue à 360°
Direction le palier intermédiaire du château d'eau, à 25 m au-dessus du sol. À Ham, nous avons de la chance : on emprunte un escalier en colimaçon pour accéder aux étages supérieurs. "Mais tous les châteaux d’eau n’ont pas d’escaliers. Certains ont encore des échelles droites", avoue Laurent Compagnon.

L'escalier en colimaçon qui monte au sommet du château d'eau de Ham. © Gaëlle Fauquembergue
On y retrouve le tuyau de refoulement, qui fait monter l'eau, et celui de distribution, qui la fait redescendre. Notre ascension se poursuit à 35 m de hauteur, jusqu'au ventre du château d'eau : les cuves de stockage de l'eau d'une capacité de 2 000 m³. "Il y en a deux pour faciliter l’exploitation, notamment les lavages annuels. Ça nous permet d’en avoir toujours une en service. Mais sinon, les deux fonctionnent en parallèle. Il y a des sondes qui mesurent en permanence le niveau de l’eau. Et quand le niveau atteint une certaine valeur, le captage reçoit l’ordre de démarrer les pompes et de remplir les cuves."

Au sommet du château d'eau de Ham, il y a deux cuves de 2000 m³. © Gaëlle Fauquembergue
La fin de notre périple nous emmène au grand air, sur le dôme du bâtiment, à 40 m de hauteur. Si la forme des châteaux d'eau est purement esthétique et doit seulement prévoir un sommet plus large que le pied, leur hauteur a une véritable importance : "l’intérêt d’être aussi haut, c’est la pression au robinet : plus le château d’eau est haut, plus on a de pression chez soi. Tous les châteaux d’eau ne sont pas aussi hauts. Ça dépend de la topographie de chaque commune. On choisit le point naturel le plus haut pour élever l’altimétrie. Un château d’eau, c’est toujours utile pour avoir de l’eau en tout temps et en tout lieu. En cas de coupure d’eau et d'électricité, ça permet de rester autonome. Ici, on peut tenir environ une journée sans électricité, mais avec de l’eau", explique Laurent Compagnon.
Un point privilégié pour la téléphonie mobile
Une hauteur qui intéresse également les opérateurs de téléphonie mobiles qui ont trouvé dans le sommet des châteaux d'eau des points privilégiés pour installer leurs antennes. "Ça leur évite de poser un pylône".

Le sommet des châteaux d'eau accueille souvent des antennes de téléphonie mobile. © Gaëlle Fauquembergue
On vous l'a dit : ne regardez pas en bas ! Admirez plutôt le paysage et cette vue panoramique à 360° : l'ancienne sucrerie d'Eppeville et ses silos et même la cathédrale de Saint-Quentin quand il fait beau.
Voilà. Vous savez maintenant comment fonctionne un château d'eau. Inutile donc de s'attarder tout là-haut. Reprenons le petit escalier en colimaçon. Redescendons sur le plancher des vaches. Sachez enfin que le plus haut château de France, 93 m, se trouve à Férel dans le Morbihan. Celui de Marcq-en-Barœul, avec ses 83 m de haut, est le plus des Hauts-de-France.

TVPI | 17.01.2025
Biarritz, restauration
du Grand Hôtel
du Grand Hôtel
Immeuble emblématique de Biarritz, ancien hôtel pour stars hollywoodiennes, hôpital durant la guerre, transformé en résidence. Ce bâtiment est classé en catégorie 1 au titre de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine et va être restauré en deux phases.
VOIR PLUS
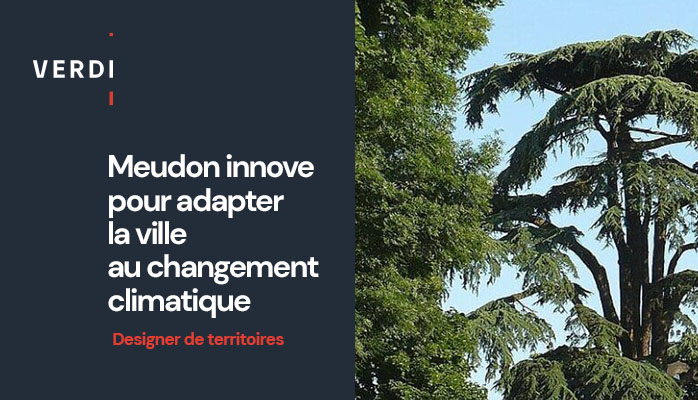
News Day FR | 18.12.2024
Meudon innove pour adapter la ville au changement climatique
Pour mieux identifier les îlots de chaleur urbains sur son territoire et leur évolution, la ville de Meudon mise sur une technologie radicalement innovante. Le changement climatique renforce la nécessité de mieux identifier localement dans les grandes villes les zones les plus sujettes à l'effet d'îlot de chaleur urbain (ICU), facteur aggravant lors d'une canicule.
VOIR PLUS
La réanimation, un phénomène climatique
Phénomène climatique, l’îlot de chaleur urbain se caractérise par des écarts de température : ces températures sont plus élevées en zone urbaine que dans les zones rurales environnantes. L’îlot de chaleur urbain est généré par la ville, sa morphologie, ses matériaux, ses conditions naturelles, climatiques et météorologiques, ses activités. En retour, elle influence le climat de la ville (températures, précipitations), les niveaux et la répartition des polluants, le confort des citadins et les éléments naturels des villes. L’îlot de chaleur urbain est un facteur aggravant des canicules et notamment des épisodes caniculaires. Or, avec le changement climatique, les vagues de chaleur et les canicules ont tendance à s’accentuer. Le phénomène d’îlot de chaleur urbain amplifie ces épisodes climatiques, notamment nocturnes, en limitant le refroidissement nocturne de la ville. On peut ainsi observer des écarts de température importants entre Paris et les zones rurales : jusqu’à 10°C lors de la canicule exceptionnelle de 2003.
Un enjeu dans les Hauts-de-Seine
Il s’agit donc d’une donnée urbaine stratégique à prendre en compte dans la conception et la gestion de la ville. Très urbanisée, la région Ile-de-France est particulièrement vulnérable à ce phénomène. Selon les chiffres de l’Institut Paris Région, plus de 3 685 000 Franciliens, soit 31 % de la population régionale, résident dans des îlots considérés comme très vulnérables à la chaleur, dont 845 000 personnes particulièrement sensibles à ce phénomène en raison de leur âge : les enfants de moins de 5 ans et les personnes de plus de 65 ans. Dans les Hauts-de-Seine, la cartographie des îlots de chaleur et des îlots de froid (IFU), établie par le service R&D de Verdi Ingénierie, montre de fortes disparités entre les différentes communes du département. Ainsi, 92 % des habitants de Levallois-Perret, qui compte près de 68 000 habitants pour une densité de près de 28 000 hab/km2, résident en USI. En revanche, à Asnières-sur-Seine, avec 88 500 habitants et une densité de 18 300 habitants au km2, le taux de bâtiments exposés est plus faible, touchant toujours 71 % de la population. Le territoire présente donc de fortes disparités au sein de villes densément peuplées, causées principalement par des taux de végétation très différents. Ces disparités sont encore plus marquées pour les communes à plus faible densité urbaine. Chatenay-Malabry, Chaville, Clamart, Garches, Le Plessis-Robinson, Marnes-La-Coquette, Meudon, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres, Vaucresson, Ville d’Avray se distinguent par la présence marquée d’îlots de fraîcheur, parfois très étendue. A l’inverse, des villes comme Levallois-Perret, Vanves, Puteaux, Montrouge, Malakoff, La Garenne-Colombe, Issy-Les-Moulineaux, Courbevoie, Clichy, Boulogne-Billancourt disposent de zones nombreuses et étendues d’îlots de chaleur urbains et de trop peu nombreuses zones insulaires fraîches.
Meudon, une ville engagée dans la transition climatique
La cartographie de ces USI et IFU est un outil essentiel pour piloter une lutte efficace contre le réchauffement climatique en milieu urbain. C’est le défi lancé par la ville de Meudon, qui utilise la technologie de simulation pour identifier les îlots de chaleur urbains (USI) présents sur son territoire. Cette expérience unique est à l’agenda de la ville depuis septembre 2024. Elle s’inscrit dans la politique environnementale d’une commune résolument engagée dans la transition climatique. La ville développe son territoire en réduisant son empreinte carbone. Elle inscrit la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité comme ses priorités. Pour cela, Meudon multiplie les opérations d’assèchement des espaces publics. Depuis 2019, 20 000 m² ont été désimperméabilisés.
Promouvoir le développement d’îlots urbains frais
Non seulement cette politique contribue à favoriser l’infiltration des eaux de pluie, mais elle permet également de réduire les îlots de chaleur et donc de gagner jusqu’à 5°C lors des canicules. La place Rabelais et ses fosses végétalisées qui relient les pieds des arbres illustrent cette politique. Cette lutte contre l’artificialisation des terres s’applique également aux cimetières municipaux, espaces traditionnellement très minéraux. La ville a gazonné les allées, verdi les murs et planté des arbres. Parallèlement, des projets ambitieux visant à transformer les espaces minéraux en îlots de verdure sont menés. En cours ou à venir, la végétalisation des places Tony de Graaff et Simone Veil ainsi que de celle devant le Centre d’art et de culture témoigne de l’engagement de la ville. La lutte contre les îlots de chaleur se déroule également dans les écoles. Chaque année, deux cours d’école sont végétalisées pour offrir aux enfants un environnement plus agréable. Avec 8 000 arbres recensés, dont 400 plantés en 2023 et 200 arbres remarquables, la ville possède un patrimoine naturel très riche. C’est le résultat d’une politique volontariste de préservation et d’adaptation de la végétation. Ce patrimoine vert favorise le développement d’îlots de fraîcheur urbains.
Suivre l’évolution des îlots de chaleur urbains
Grâce à son partenariat avec Dassault Systèmes, Meudon utilise la technologie de simulation pour créer le jumeau virtuel de trois espaces publics, où des projets d’aménagement sont en cours pour les transformer en espaces plus verts. Les simulations visent à calculer et évaluer la circulation de l’air et la température dans ces trois sites. Ils prennent en compte différentes conditions météorologiques à différents moments de la journée en intégrant les bâtiments, les arbres, les routes, le sol, le vent, la lumière du soleil et d’autres facteurs dans le jumeau virtuel. Ces simulations permettront d’éclairer, à la lumière de la science, les orientations futures d’aménagement des espaces publics de la ville, tout en fournissant aux élus municipaux des indications quant à l’atténuation de ces phénomènes d’îlots de chaleur. En ville, la chaleur emmagasinée est plus importante. Le modèle d’urbanisation, les revêtements de sol, le manque de végétation ou d’eau dans les espaces publics sont autant de facteurs qui empêchent le refroidissement de l’espace urbain. Les bâtiments élevés et la densité des murs ralentissent la circulation de l’air et le bâtiment emmagasine la chaleur. Les matériaux de construction comme le béton, la brique ou la pierre captent facilement la chaleur le jour, grâce au rayonnement solaire, et la restituent progressivement dans l’atmosphère la nuit, empêchant ainsi l’air de se refroidir, soulignent les experts de Météo-France…
Le département mise sur les îles vertes
Afin de lutter contre les îlots de chaleur, le département réorganise progressivement les cursus des collèges publics. Plus verts et plus accueillants, les cours nouvelle génération contribuent également à améliorer l’environnement de travail des 74 000 étudiants du collège Altosequan. Ce projet ambitieux s’inscrit dans l’Agenda 2030 du département.
40 millions d’euros, c’est le budget investi par le département des Hauts-de-Seine pour son programme de végétalisation des cours des collèges. Lancé en 2022, après concertation avec les collégiens, ce dispositif vise à améliorer le quotidien des élèves, à offrir des espaces de détente aux enseignants et personnels hébergés sur place et à s’adapter aux enjeux environnementaux. En effet, c’est une réponse efficace à la lutte contre les îlots de chaleur urbains et à la réduction des apports d’eau de pluie dans le réseau d’assainissement. Établissement pilote, le collège Jean-Macé de Clichy-la-Garenne a inauguré son île verte fin 2021. D’ici 2027, 38 collèges publics des Hauts-de-Seine seront réaménagés.
Phénomène climatique, l’îlot de chaleur urbain se caractérise par des écarts de température : ces températures sont plus élevées en zone urbaine que dans les zones rurales environnantes. L’îlot de chaleur urbain est généré par la ville, sa morphologie, ses matériaux, ses conditions naturelles, climatiques et météorologiques, ses activités. En retour, elle influence le climat de la ville (températures, précipitations), les niveaux et la répartition des polluants, le confort des citadins et les éléments naturels des villes. L’îlot de chaleur urbain est un facteur aggravant des canicules et notamment des épisodes caniculaires. Or, avec le changement climatique, les vagues de chaleur et les canicules ont tendance à s’accentuer. Le phénomène d’îlot de chaleur urbain amplifie ces épisodes climatiques, notamment nocturnes, en limitant le refroidissement nocturne de la ville. On peut ainsi observer des écarts de température importants entre Paris et les zones rurales : jusqu’à 10°C lors de la canicule exceptionnelle de 2003.
Un enjeu dans les Hauts-de-Seine
Il s’agit donc d’une donnée urbaine stratégique à prendre en compte dans la conception et la gestion de la ville. Très urbanisée, la région Ile-de-France est particulièrement vulnérable à ce phénomène. Selon les chiffres de l’Institut Paris Région, plus de 3 685 000 Franciliens, soit 31 % de la population régionale, résident dans des îlots considérés comme très vulnérables à la chaleur, dont 845 000 personnes particulièrement sensibles à ce phénomène en raison de leur âge : les enfants de moins de 5 ans et les personnes de plus de 65 ans. Dans les Hauts-de-Seine, la cartographie des îlots de chaleur et des îlots de froid (IFU), établie par le service R&D de Verdi Ingénierie, montre de fortes disparités entre les différentes communes du département. Ainsi, 92 % des habitants de Levallois-Perret, qui compte près de 68 000 habitants pour une densité de près de 28 000 hab/km2, résident en USI. En revanche, à Asnières-sur-Seine, avec 88 500 habitants et une densité de 18 300 habitants au km2, le taux de bâtiments exposés est plus faible, touchant toujours 71 % de la population. Le territoire présente donc de fortes disparités au sein de villes densément peuplées, causées principalement par des taux de végétation très différents. Ces disparités sont encore plus marquées pour les communes à plus faible densité urbaine. Chatenay-Malabry, Chaville, Clamart, Garches, Le Plessis-Robinson, Marnes-La-Coquette, Meudon, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres, Vaucresson, Ville d’Avray se distinguent par la présence marquée d’îlots de fraîcheur, parfois très étendue. A l’inverse, des villes comme Levallois-Perret, Vanves, Puteaux, Montrouge, Malakoff, La Garenne-Colombe, Issy-Les-Moulineaux, Courbevoie, Clichy, Boulogne-Billancourt disposent de zones nombreuses et étendues d’îlots de chaleur urbains et de trop peu nombreuses zones insulaires fraîches.
Meudon, une ville engagée dans la transition climatique
La cartographie de ces USI et IFU est un outil essentiel pour piloter une lutte efficace contre le réchauffement climatique en milieu urbain. C’est le défi lancé par la ville de Meudon, qui utilise la technologie de simulation pour identifier les îlots de chaleur urbains (USI) présents sur son territoire. Cette expérience unique est à l’agenda de la ville depuis septembre 2024. Elle s’inscrit dans la politique environnementale d’une commune résolument engagée dans la transition climatique. La ville développe son territoire en réduisant son empreinte carbone. Elle inscrit la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité comme ses priorités. Pour cela, Meudon multiplie les opérations d’assèchement des espaces publics. Depuis 2019, 20 000 m² ont été désimperméabilisés.
Promouvoir le développement d’îlots urbains frais
Non seulement cette politique contribue à favoriser l’infiltration des eaux de pluie, mais elle permet également de réduire les îlots de chaleur et donc de gagner jusqu’à 5°C lors des canicules. La place Rabelais et ses fosses végétalisées qui relient les pieds des arbres illustrent cette politique. Cette lutte contre l’artificialisation des terres s’applique également aux cimetières municipaux, espaces traditionnellement très minéraux. La ville a gazonné les allées, verdi les murs et planté des arbres. Parallèlement, des projets ambitieux visant à transformer les espaces minéraux en îlots de verdure sont menés. En cours ou à venir, la végétalisation des places Tony de Graaff et Simone Veil ainsi que de celle devant le Centre d’art et de culture témoigne de l’engagement de la ville. La lutte contre les îlots de chaleur se déroule également dans les écoles. Chaque année, deux cours d’école sont végétalisées pour offrir aux enfants un environnement plus agréable. Avec 8 000 arbres recensés, dont 400 plantés en 2023 et 200 arbres remarquables, la ville possède un patrimoine naturel très riche. C’est le résultat d’une politique volontariste de préservation et d’adaptation de la végétation. Ce patrimoine vert favorise le développement d’îlots de fraîcheur urbains.
Suivre l’évolution des îlots de chaleur urbains
Grâce à son partenariat avec Dassault Systèmes, Meudon utilise la technologie de simulation pour créer le jumeau virtuel de trois espaces publics, où des projets d’aménagement sont en cours pour les transformer en espaces plus verts. Les simulations visent à calculer et évaluer la circulation de l’air et la température dans ces trois sites. Ils prennent en compte différentes conditions météorologiques à différents moments de la journée en intégrant les bâtiments, les arbres, les routes, le sol, le vent, la lumière du soleil et d’autres facteurs dans le jumeau virtuel. Ces simulations permettront d’éclairer, à la lumière de la science, les orientations futures d’aménagement des espaces publics de la ville, tout en fournissant aux élus municipaux des indications quant à l’atténuation de ces phénomènes d’îlots de chaleur. En ville, la chaleur emmagasinée est plus importante. Le modèle d’urbanisation, les revêtements de sol, le manque de végétation ou d’eau dans les espaces publics sont autant de facteurs qui empêchent le refroidissement de l’espace urbain. Les bâtiments élevés et la densité des murs ralentissent la circulation de l’air et le bâtiment emmagasine la chaleur. Les matériaux de construction comme le béton, la brique ou la pierre captent facilement la chaleur le jour, grâce au rayonnement solaire, et la restituent progressivement dans l’atmosphère la nuit, empêchant ainsi l’air de se refroidir, soulignent les experts de Météo-France…
Le département mise sur les îles vertes
Afin de lutter contre les îlots de chaleur, le département réorganise progressivement les cursus des collèges publics. Plus verts et plus accueillants, les cours nouvelle génération contribuent également à améliorer l’environnement de travail des 74 000 étudiants du collège Altosequan. Ce projet ambitieux s’inscrit dans l’Agenda 2030 du département.
40 millions d’euros, c’est le budget investi par le département des Hauts-de-Seine pour son programme de végétalisation des cours des collèges. Lancé en 2022, après concertation avec les collégiens, ce dispositif vise à améliorer le quotidien des élèves, à offrir des espaces de détente aux enseignants et personnels hébergés sur place et à s’adapter aux enjeux environnementaux. En effet, c’est une réponse efficace à la lutte contre les îlots de chaleur urbains et à la réduction des apports d’eau de pluie dans le réseau d’assainissement. Établissement pilote, le collège Jean-Macé de Clichy-la-Garenne a inauguré son île verte fin 2021. D’ici 2027, 38 collèges publics des Hauts-de-Seine seront réaménagés.

Charente Libre | 05.12.2024
l'Agglo continue son combat pour rendre l'eau plus saine
La station de traitement des pesticides construite par Grand Cognac a été unaugurée, hier, à Merpins. 250 métabolites, des résidus de pesticides, y sont recherchés et, pour l'instant, les taux sont en dessous du seuil de détection.
VOIR PLUS
En plein cœur d'un quartier résidentiel de Merpins, la station de traitement des pesticides est en fonctionnement, depuis la mi-septembre, “ sans nuisance sonore ” précise le maire de la ville, Hubert Demenier. L'ancienne station de pompage, en usage depuis les années 60 a été réhabilitée. “ On a repris des cuves et le système de pompage existants ”, explique Anne-Lise Autret, maître d'œuvre pour Verdi “ On a construit une grande cuve de 300 m3 pour stocker l'eau propre. ”

À côté de Mickael Villeger, élu à Grand Cognac (2e droite) et du maire de Merpins, Hubert Demenier, les représentant de Suez et Verdi et le service assainissement de Grand Cognac
A l'intérieur du bâtiment, trois grandes cuves bleues ont été installées. C'est là que l'eau est filtrée, débarrassée des métabolites, les molécules issues de la dégradation des pesticides comme I’atrazine et le métolachlore, qui s'infiltrent ensuite dans les eaux souterraines. “ Les molécules se fixent sur le charbon. Près de 280 mètres cubes d'eau passent dans les cuves chaque heure ”, précise Anne-Lise Autret. La station nettoie chaque année plus d'un million de mètres cubes d'eau, soit 19 % de la production de l'agglomération. La station alimente plus de 11 500 habitants, répartis sur 14 communes.

La station de traitement des pesticides de Merpins a été installée dans une ancienne usine station de pompage.
Du charbon comme filtre
Grand Cognac a choisi de traiter les eaux avec “ des filtres à charbon actif en grain à renouvellement continu ”. Du charbon, une fois usagé, “ envoyé en Belgique où il est retraité, et qui revient ensuite ici pour servir de nouveau comme filtre ”, explique la maître d'œuvre. “ On élimine tous les métabolismes, on est en dessous des seuils de détection ” indique Mickael Villeger, le vice-président chargé du grand et petit cycle de l'eau à Grand Cognac. “ Plus de 250 métabolites sont recherchés, et on continue à en découvrir. Si je dois choisir entre l'eau en bouteille et l’eau du robinet, je bois celle du robinet ”, souligne l'élu.
L'Agglo poursuit son effort pour éliminer les traces de résidus de produits phytosanitaires. Après la station de Merpins, elle en a mis une autre en route à Jamac, et est en train d'en construire une à Angeac-Charente. En tout, plus de 6millions d'euros d'argent public ont été investis pour nettoyer l'eau de ces résidus de pesticides.
“ Les seuils qualitatifs ont été relevés, alors on n'avait pas d'obligation de construire à Angeac, mais on considère qu'on doit éliminer tous les métabolites ”, insiste Mickael
Villeger. “ II était de notre responsabilité d'agir mais cette usine n'est qu'une partie de notre stratégie, il faut aussi de la prévention, et réduire l'usage des pesticides ”, complète l'élu. Parmi les actions menées, de la sensibilisation et de l'accompagnement auprès du secteur agricole, mais aussi l'acquisition de parcelles pour installer du maraîchage bio ou du couvert mellifère.
Pourquoi traiter les eaux de Grand Cognac ?
Plusieurs relevés effectués depuis 2018 sur l’eau distribuée sur Grand Cognac ont été mis à jour des taux trop élevés de certains métabolismes comme l’ESA métolachlore, issu d’un herbicide et détecté à un niveau de 0,65 microgramme par litre au point de captage d’Angeac-Charente ou 0,93 mg/l à Merpins. Le seuil réglementaire étant fixé à 0,1 mg/l et relevé en 2022 à 0,9 mg/l par l’Anses (l’Agence national de sécurité sanitaire). Le seuil d’interdiction de consommation de l’eau est fixé à 500 mg/l. L’Agglo avait demandé des dérogations pour continuer à pouvoir distribuer l’eau jusqu’à la mise en place de ces stations de traitement.

À côté de Mickael Villeger, élu à Grand Cognac (2e droite) et du maire de Merpins, Hubert Demenier, les représentant de Suez et Verdi et le service assainissement de Grand Cognac
A l'intérieur du bâtiment, trois grandes cuves bleues ont été installées. C'est là que l'eau est filtrée, débarrassée des métabolites, les molécules issues de la dégradation des pesticides comme I’atrazine et le métolachlore, qui s'infiltrent ensuite dans les eaux souterraines. “ Les molécules se fixent sur le charbon. Près de 280 mètres cubes d'eau passent dans les cuves chaque heure ”, précise Anne-Lise Autret. La station nettoie chaque année plus d'un million de mètres cubes d'eau, soit 19 % de la production de l'agglomération. La station alimente plus de 11 500 habitants, répartis sur 14 communes.

La station de traitement des pesticides de Merpins a été installée dans une ancienne usine station de pompage.
Du charbon comme filtre
Grand Cognac a choisi de traiter les eaux avec “ des filtres à charbon actif en grain à renouvellement continu ”. Du charbon, une fois usagé, “ envoyé en Belgique où il est retraité, et qui revient ensuite ici pour servir de nouveau comme filtre ”, explique la maître d'œuvre. “ On élimine tous les métabolismes, on est en dessous des seuils de détection ” indique Mickael Villeger, le vice-président chargé du grand et petit cycle de l'eau à Grand Cognac. “ Plus de 250 métabolites sont recherchés, et on continue à en découvrir. Si je dois choisir entre l'eau en bouteille et l’eau du robinet, je bois celle du robinet ”, souligne l'élu.
L'Agglo poursuit son effort pour éliminer les traces de résidus de produits phytosanitaires. Après la station de Merpins, elle en a mis une autre en route à Jamac, et est en train d'en construire une à Angeac-Charente. En tout, plus de 6millions d'euros d'argent public ont été investis pour nettoyer l'eau de ces résidus de pesticides.
“ Les seuils qualitatifs ont été relevés, alors on n'avait pas d'obligation de construire à Angeac, mais on considère qu'on doit éliminer tous les métabolites ”, insiste Mickael
Villeger. “ II était de notre responsabilité d'agir mais cette usine n'est qu'une partie de notre stratégie, il faut aussi de la prévention, et réduire l'usage des pesticides ”, complète l'élu. Parmi les actions menées, de la sensibilisation et de l'accompagnement auprès du secteur agricole, mais aussi l'acquisition de parcelles pour installer du maraîchage bio ou du couvert mellifère.
Pourquoi traiter les eaux de Grand Cognac ?
Plusieurs relevés effectués depuis 2018 sur l’eau distribuée sur Grand Cognac ont été mis à jour des taux trop élevés de certains métabolismes comme l’ESA métolachlore, issu d’un herbicide et détecté à un niveau de 0,65 microgramme par litre au point de captage d’Angeac-Charente ou 0,93 mg/l à Merpins. Le seuil réglementaire étant fixé à 0,1 mg/l et relevé en 2022 à 0,9 mg/l par l’Anses (l’Agence national de sécurité sanitaire). Le seuil d’interdiction de consommation de l’eau est fixé à 500 mg/l. L’Agglo avait demandé des dérogations pour continuer à pouvoir distribuer l’eau jusqu’à la mise en place de ces stations de traitement.

Construction moderne n°166 | 03.12.2024
Une nouvelle capitainerie
pour le port de Calais
pour le port de Calais
Avec ses 38 mètres de hauteur et ses strates maintenues en équilibre par une force mystérieuse, la capitainerie du port de Calais veille majestueusement sur l'horizon marin.
VOIR PLUS
Texte: Sophie Trelcat | photo ©Nicolas Da Silva Lucas
Le port de Calais, ancré dans l’histoire depuis le Xe siècle, fut témoin de l’arrivée de Richard Cœur de Lion en 1189, avant qu’il ne parte en croisade. Depuis lors, ce port n’a cessé d’évoluer et de se moderniser. L’année 1928, tout aussi emblématique, voit la création par le capitaine Stuart Townsend de la première ligne de transport de voitures grâce aux Car Ferries. Depuis leur mise en service, ces navires ont proliféré en nombre et en taille, atteignant aujourd’hui des dimensions impressionnantes de 213 m de long et 32 m de large. En parallèle, les infrastructures maritimes – plateformes, passerelles, bassins, jetées et quais d’accostage – ont dû s’adapter et grandir pour accompagner cette croissance. En 1994, l’ouverture du tunnel sous la Manche a paradoxalement stimulé le trafic routier des camions, renforçant ainsi le fret maritime. Cependant, au tournant du siècle, le port de Calais s’est retrouvé confronté à un manque d’espace terrestre, freinant ainsi les possibilités de développement et de diversification, notamment en ce qui concerne les autoroutes ferroviaires. C’est ainsi qu’est né le projet ambitieux “ Calais Port 2015 ”. Visionnaire, celui-ci a permis de gagner 45 ha sur la mer et de construire une nouvelle digue de 3,2 km, doublant la capacité du port. Grâce à cette expansion, Calais a pu conserver son statut prestigieux : il demeure le premier port français pour les voyageurs et le trafic transmanche, le premier port roulier, et se classe au quatrième rang des ports commerciaux français. En 2007, il fut le premier à recevoir le label Écoport, reconnaissant ses efforts en matière de développement durable. C’est dans ce contexte de renouveau et de modernisation que la nouvelle capitainerie a été édifiée, épilogue bienheureux de l’extension des équipements portuaires de Calais.
La commande
Offrant une superficie agrandie totalisant 708 m², la capitainerie a été relocalisée à la jonction de l’ancien et du nouveau port. L’agence lilloise Atelier 9.81, forte d’une expertise avérée dans la fusion de l’architecture et du territoire, a assuré la réalisation de ce projet, remporté à l’issue d’un appel d’offres en 2019. La mission était de bâtir une tour de contrôle maritime avec un plancher bas culminant à 38 m, permettant aux opérateurs de dominer les immenses ferries et de surveiller le paysage pour réguler le trafic transmanche.
Outre l’installation d’une vigie sommitale, le projet comprenait également l’aménagement d’une salle de crise, de nombreux locaux techniques et des bureaux de commande pour les éclusiers, désormais regroupés sur ce site unique. La construction, entièrement en béton, représentait plusieurs défis, notamment en raison des préconisations sismiques de niveau 2. Cependant, l’exigence de sécurité maximale ainsi que la résistance de la tour aux vents violents et à l’environnement salin de la Côte d’Opale ont constitué des enjeux majeurs. Tous les éléments constitutifs du bâtiment doivent donc être de qualité supérieure.
Dès le début du projet, le choix d’un édifice entièrement en béton brut s’est imposé. Ce matériau, capable de répondre aux contraintes techniques et programmatiques, a été sublimé par les architectes pour en faire un élément esthétique : en s’inspirant du paysage de cette vaste plage du Nord, bordée d’une mer vert jade et s’étendant à l’ouest jusqu’au cap Blanc-Nez, les créateurs ont imaginé une forme architecturale qui s’intègre dans le territoire comme une œuvre de land art.

Une fragmentation du programme
“ Nous nous sommes inspirés du cairn, cet empilement de galets que l’on crée sur la plage, symbolisant à la fois l’autonomie des éléments et le mouvement ”, explique Cédric Michel, architecte et cofondateur de l’agence Atelier 9.81 avec Geoffrey Galand. Ici, l’architecture se veut narrative, se matérialisant sous la forme d’une accumulation de strates, autonomes et légèrement décalées. Chacune d’entre elles, correspondant à une entité programmatique, raconte l’identité du territoire calaisien, évoquant plus précisément le patrimoine géologique, géographique et historique de la ville à travers des motifs inscrits dans la masse.
Le volume le plus imposant, situé en partie basse, ancre solidement la tour dans le site. Ses façades, creusées de lignes fracturées, rappellent les anfractuosités des falaises du cap Gris-Nez et du cap Blanc-Nez, accentuées par la taille en biseau des rebords de fenêtres ainsi protégés des oiseaux de mer. Élevée sur trois niveaux, cette section – la seule non préfabriquée, réalisée en béton coulé – abrite le hall aux triples vitrages, le bureau du capitaine, ceux des éclusiers et la salle de crise. Des tisaneries et d’imposants locaux techniques ont été aménagés à chaque étage.
Les deux niveaux intermédiaires, plus fins, accueillent également des installations techniques ainsi que les circulations verticales. Un sablage du béton, avec certaines parties protégées par des pochoirs, a permis de représenter la carte maritime du détroit de la Manche. Cette technique, en enlevant une fine couche de laitance de la matière, définit le dessin par rugosité.

Enfin, le parallélépipède supérieur évoque l’histoire du développement de la ville, autrefois un grand centre de production de dentelle. Des éléments en silicone, placés dans les moules des prémurs de béton, ont créé un relief de cercles en pointillés. Cette trame représente les cartes perforées utilisées pour fabriquer les motifs de la dentelle. Certains de ces motifs circulaires sont percés et abritent un oculus apportant de la lumière dans la cuisine et les salles de repos. La vigie, située en partie supérieure, conçue avec l’aide d’un expert maritime, est un plateau libre entièrement vitré, offrant un panorama à 360 degrés sur le trafic maritime. “ La salle peinte en noir et les vitrages obliques évitent tout éblouissement et maintiennent le regard focalisé vers la mer”, précise Cédric Michel. Enfin, la sous-vigie qui lui est reliée accueille vestiaires et cuisine, ce qui permet aux opérateurs de garde de profiter d’un moment de pause à proximité immédiate de leur poste.
Le façonnage du béton La forme épurée de la capitainerie découle d’une géométrie subtilement élaborée, visant à rendre palpable l’autonomie des volumes tout en jouant sur la perception de l’équilibre, sans induire de fragilité. La réalisation des prémurs en béton a exigé de nombreux échanges avec les entreprises : “ La formulation des bétons est classique, mais ils possèdent une classe d’exposition XS3 pour se prémunir contre la corrosion des armatures par les chlorures d’eau de mer ”, explique Cédric Michel. Cette résistance aux embruns marins a nécessité un processus de fabrication minutieux, incluant un passage en chambre de durcissement pendant une dizaine d’heures. “ Nous avons été très exigeants sur la qualité des bétons. En collaboration avec le fabricant, nous avons modélisé et ajusté les dessins en fonction du calepinage des panneaux ”, poursuit l’architecte.
Quant à la structure, elle est faite d’une colonne vertébrale assurant la stabilité et la solidité de l’ensemble. Constituant le noyau central de la volumétrie, cette ossature très profondément fondée est également réalisée en prémurs de 25 cm d’épaisseur. Au fil de la fabrication de l’ouvrage, qui a demandé un étayage conséquent, de nombreux tests ont été effectués pour garantir tant l’homogénéité de la couleur des bétons que l’autonomie des blocs superposés, grâce à la juxtaposition parfaite des panneaux préservant la continuité des dessins.
Les multiples réunions avec les utilisateurs ont confirmé le fonctionnement impeccable de la capitainerie. Le recours au BIM s’est révélé être un outil essentiel dans la réussite de cet édifice d’exception, dont la présence énigmatique stimule l’imaginaire et exalte la poésie de ce territoire portuaire.

Maître d’ouvrage : région Hauts-de-France
Maîtres d’œuvre : Atelier 9.81 (architecte mandataire) ; LAH/AT (architecte associé) ; Prems (expert maritime). BET : Verdi bâtiment Nord de France (TCE), Verdi Nord de France (VRD)
Entreprises gros œuvre :
Léon Grosse (mandataire du clos couvert) ; Soriba (préfabricant)
Surface : 708 m2 SU
Coût : 4 738 836 € HT
Programme : vigie, sous-vigie (locaux de vie et locaux techniques), poste de commande, bureaux et salle de réunion, locaux techniques.
Le port de Calais, ancré dans l’histoire depuis le Xe siècle, fut témoin de l’arrivée de Richard Cœur de Lion en 1189, avant qu’il ne parte en croisade. Depuis lors, ce port n’a cessé d’évoluer et de se moderniser. L’année 1928, tout aussi emblématique, voit la création par le capitaine Stuart Townsend de la première ligne de transport de voitures grâce aux Car Ferries. Depuis leur mise en service, ces navires ont proliféré en nombre et en taille, atteignant aujourd’hui des dimensions impressionnantes de 213 m de long et 32 m de large. En parallèle, les infrastructures maritimes – plateformes, passerelles, bassins, jetées et quais d’accostage – ont dû s’adapter et grandir pour accompagner cette croissance. En 1994, l’ouverture du tunnel sous la Manche a paradoxalement stimulé le trafic routier des camions, renforçant ainsi le fret maritime. Cependant, au tournant du siècle, le port de Calais s’est retrouvé confronté à un manque d’espace terrestre, freinant ainsi les possibilités de développement et de diversification, notamment en ce qui concerne les autoroutes ferroviaires. C’est ainsi qu’est né le projet ambitieux “ Calais Port 2015 ”. Visionnaire, celui-ci a permis de gagner 45 ha sur la mer et de construire une nouvelle digue de 3,2 km, doublant la capacité du port. Grâce à cette expansion, Calais a pu conserver son statut prestigieux : il demeure le premier port français pour les voyageurs et le trafic transmanche, le premier port roulier, et se classe au quatrième rang des ports commerciaux français. En 2007, il fut le premier à recevoir le label Écoport, reconnaissant ses efforts en matière de développement durable. C’est dans ce contexte de renouveau et de modernisation que la nouvelle capitainerie a été édifiée, épilogue bienheureux de l’extension des équipements portuaires de Calais.
La commande
Offrant une superficie agrandie totalisant 708 m², la capitainerie a été relocalisée à la jonction de l’ancien et du nouveau port. L’agence lilloise Atelier 9.81, forte d’une expertise avérée dans la fusion de l’architecture et du territoire, a assuré la réalisation de ce projet, remporté à l’issue d’un appel d’offres en 2019. La mission était de bâtir une tour de contrôle maritime avec un plancher bas culminant à 38 m, permettant aux opérateurs de dominer les immenses ferries et de surveiller le paysage pour réguler le trafic transmanche.
Outre l’installation d’une vigie sommitale, le projet comprenait également l’aménagement d’une salle de crise, de nombreux locaux techniques et des bureaux de commande pour les éclusiers, désormais regroupés sur ce site unique. La construction, entièrement en béton, représentait plusieurs défis, notamment en raison des préconisations sismiques de niveau 2. Cependant, l’exigence de sécurité maximale ainsi que la résistance de la tour aux vents violents et à l’environnement salin de la Côte d’Opale ont constitué des enjeux majeurs. Tous les éléments constitutifs du bâtiment doivent donc être de qualité supérieure.
Dès le début du projet, le choix d’un édifice entièrement en béton brut s’est imposé. Ce matériau, capable de répondre aux contraintes techniques et programmatiques, a été sublimé par les architectes pour en faire un élément esthétique : en s’inspirant du paysage de cette vaste plage du Nord, bordée d’une mer vert jade et s’étendant à l’ouest jusqu’au cap Blanc-Nez, les créateurs ont imaginé une forme architecturale qui s’intègre dans le territoire comme une œuvre de land art.

Une fragmentation du programme
“ Nous nous sommes inspirés du cairn, cet empilement de galets que l’on crée sur la plage, symbolisant à la fois l’autonomie des éléments et le mouvement ”, explique Cédric Michel, architecte et cofondateur de l’agence Atelier 9.81 avec Geoffrey Galand. Ici, l’architecture se veut narrative, se matérialisant sous la forme d’une accumulation de strates, autonomes et légèrement décalées. Chacune d’entre elles, correspondant à une entité programmatique, raconte l’identité du territoire calaisien, évoquant plus précisément le patrimoine géologique, géographique et historique de la ville à travers des motifs inscrits dans la masse.
Le volume le plus imposant, situé en partie basse, ancre solidement la tour dans le site. Ses façades, creusées de lignes fracturées, rappellent les anfractuosités des falaises du cap Gris-Nez et du cap Blanc-Nez, accentuées par la taille en biseau des rebords de fenêtres ainsi protégés des oiseaux de mer. Élevée sur trois niveaux, cette section – la seule non préfabriquée, réalisée en béton coulé – abrite le hall aux triples vitrages, le bureau du capitaine, ceux des éclusiers et la salle de crise. Des tisaneries et d’imposants locaux techniques ont été aménagés à chaque étage.
Les deux niveaux intermédiaires, plus fins, accueillent également des installations techniques ainsi que les circulations verticales. Un sablage du béton, avec certaines parties protégées par des pochoirs, a permis de représenter la carte maritime du détroit de la Manche. Cette technique, en enlevant une fine couche de laitance de la matière, définit le dessin par rugosité.

Enfin, le parallélépipède supérieur évoque l’histoire du développement de la ville, autrefois un grand centre de production de dentelle. Des éléments en silicone, placés dans les moules des prémurs de béton, ont créé un relief de cercles en pointillés. Cette trame représente les cartes perforées utilisées pour fabriquer les motifs de la dentelle. Certains de ces motifs circulaires sont percés et abritent un oculus apportant de la lumière dans la cuisine et les salles de repos. La vigie, située en partie supérieure, conçue avec l’aide d’un expert maritime, est un plateau libre entièrement vitré, offrant un panorama à 360 degrés sur le trafic maritime. “ La salle peinte en noir et les vitrages obliques évitent tout éblouissement et maintiennent le regard focalisé vers la mer”, précise Cédric Michel. Enfin, la sous-vigie qui lui est reliée accueille vestiaires et cuisine, ce qui permet aux opérateurs de garde de profiter d’un moment de pause à proximité immédiate de leur poste.
Le façonnage du béton La forme épurée de la capitainerie découle d’une géométrie subtilement élaborée, visant à rendre palpable l’autonomie des volumes tout en jouant sur la perception de l’équilibre, sans induire de fragilité. La réalisation des prémurs en béton a exigé de nombreux échanges avec les entreprises : “ La formulation des bétons est classique, mais ils possèdent une classe d’exposition XS3 pour se prémunir contre la corrosion des armatures par les chlorures d’eau de mer ”, explique Cédric Michel. Cette résistance aux embruns marins a nécessité un processus de fabrication minutieux, incluant un passage en chambre de durcissement pendant une dizaine d’heures. “ Nous avons été très exigeants sur la qualité des bétons. En collaboration avec le fabricant, nous avons modélisé et ajusté les dessins en fonction du calepinage des panneaux ”, poursuit l’architecte.
Quant à la structure, elle est faite d’une colonne vertébrale assurant la stabilité et la solidité de l’ensemble. Constituant le noyau central de la volumétrie, cette ossature très profondément fondée est également réalisée en prémurs de 25 cm d’épaisseur. Au fil de la fabrication de l’ouvrage, qui a demandé un étayage conséquent, de nombreux tests ont été effectués pour garantir tant l’homogénéité de la couleur des bétons que l’autonomie des blocs superposés, grâce à la juxtaposition parfaite des panneaux préservant la continuité des dessins.
Les multiples réunions avec les utilisateurs ont confirmé le fonctionnement impeccable de la capitainerie. Le recours au BIM s’est révélé être un outil essentiel dans la réussite de cet édifice d’exception, dont la présence énigmatique stimule l’imaginaire et exalte la poésie de ce territoire portuaire.

Maître d’ouvrage : région Hauts-de-France
Maîtres d’œuvre : Atelier 9.81 (architecte mandataire) ; LAH/AT (architecte associé) ; Prems (expert maritime). BET : Verdi bâtiment Nord de France (TCE), Verdi Nord de France (VRD)
Entreprises gros œuvre :
Léon Grosse (mandataire du clos couvert) ; Soriba (préfabricant)
Surface : 708 m2 SU
Coût : 4 738 836 € HT
Programme : vigie, sous-vigie (locaux de vie et locaux techniques), poste de commande, bureaux et salle de réunion, locaux techniques.


 Designer de territoires
Designer de territoires Suivez-nous sur Linkedin
Suivez-nous sur Linkedin