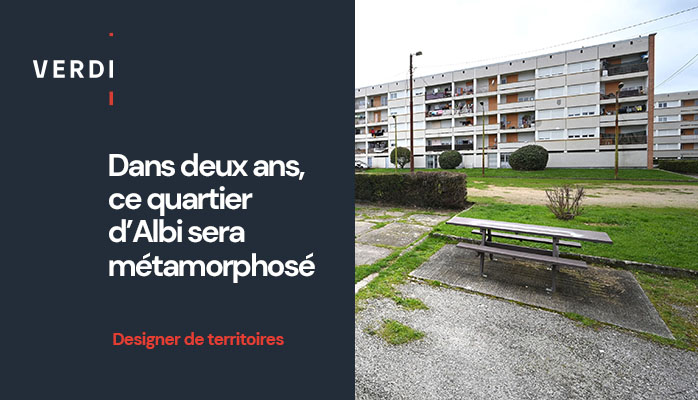
La Depeche.fr | 06.03.2024
Albi : Dans deux ans,
ce quartier sera métamorphosé
ce quartier sera métamorphosé
Le quartier de Lapanouse va être profondément modifié dans les deux prochaines années. Mardi soir, la ville, l'Agglo et Tarn Habitat ont présenté les travaux aux habitants.
VOIR PLUS
Voilà plusieurs années que les habitants de Lapanouse réclament un aménagement de leur quartier. Lors des réunions de quartiers, la question revenait sans cesse. Mardi soir, une partie ont pu découvrir que dans les deux prochaines années Lapanouse allait profondément changer. Le cœur principalement. Il sera plus vert, avec plus d’espaces de vie. Plus agréable à vivre.

L’espace va être transformé en un parking enherbé
Une première tranche de travaux aura lieu cette année. Elle consistera en la démolition de la salle Vincent-Garcia, inutilisé depuis des années. Elle débutera dans quelques jours. Toujours en été, un espace de musculation en plein air sera bâti à côté de la maison de quartier. C’est un des projets retenus dans le cadre du budget participatif. Du mobilier urbain (bancs et table de pique-nique) sera également installé dans ce secteur.
2025 sera l’année des grands travaux.
La place de la salle démolie, un parking sera créé. Il sera enherbé. Sa construction permettra de dégager les voitures de la place Abrial et de redonner cet espace aux habitants. Pour ce faire, le bitume sera enlevé pour laisser place à une aire de jeux et à des espaces de rencontres. Le changement sera énorme. De 365 m2 d’espaces verts, on passera à plus de 1 000 m2. Auxquels il faut ajouter 595 m2 d’aire de jeux. Soit 70 % de la surface. Un cheminement piéton et cyclable sera créé pour relier les différents points du quartier. La place de la Marne sera végétalisée. Mais pas de panique pour les commerces, les places de stationnement seront conservées. Au total, les espaces verts passeront de 307 m2 à 587. Soit 40 % de la place.
Les containers enterrés seront déplacés. Et le carrefour de la rue de Jarlard sera sécurisé. “ Peut-être avec 4 stops ”, plaisante Stéphanie Guiraud-Chaumeil, la maire et présidente de l’Agglo. Au total, c’est 1,5 M d’euros que l’Agglo et la ville vont investir sur le quartier. Ce projet a été travaillé avec les habitants. De nouvelles réunions auront lieu pour définir un projet définitif en septembre.
De son côté, Tarn Habitat a travaillé en amont à l’attractivité de la place de la Marne, afin d’attirer de nouveaux commerces. 50 000 euros ont été investis pour moderniser l’espace commercial et améliorer l’accès des commerces. Aujourd’hui, on compte quatre commerces dont un va fermer. Et plusieurs locaux accueillant des services comme le Carré public... Il reste deux locaux vacants. La présidente, Florence Belou a rappelé à ce titre, que les commerces qui voulaient s’installer pouvaient bénéficier de loyer adapté et d’aides. Avis aux amateurs.
A l’été 2025, le bailleur social va procéder à une végétalisation du bas des immeubles. Cela se fera bâtiment par bâtiment en fonction des attentes des locataires. Le but de ces travaux est de recréer des espaces à vivre aux habitants. De transformer leur vie, précise Michel Franques, 1er adjoint et conseiller départemental du quartier. Ces travaux ne concernent que les extérieurs. Pour l’instant, il nées pas question de rénovation des logements. Tarn Habitat a déjà mis 2 M d’euro sur le quartier. “ Il n’y a pas d’urgence technique sur le bâtiment, souligne le directeur. Et le bailleur mène déjà de gros travaux sur la ville : Cantepau et la Tour Saint-Martin. ”
“ Cet aménagement était un engagement de campagne. Nous allons enfin annoncer aux habitants les projets qu’ils attendent ” ; a rappelé Stéphanie Guiraud-Chaumeil. En 2021, des habitants et commerçants de Lapanouse avaient fait part de leur exaspération quant à l’état d’abandon de la place de la Marne. Ce qui avait donné lieu à un échange aigre doux entre Tarn Habitat et la ville.

L’espace va être transformé en un parking enherbé
Une première tranche de travaux aura lieu cette année. Elle consistera en la démolition de la salle Vincent-Garcia, inutilisé depuis des années. Elle débutera dans quelques jours. Toujours en été, un espace de musculation en plein air sera bâti à côté de la maison de quartier. C’est un des projets retenus dans le cadre du budget participatif. Du mobilier urbain (bancs et table de pique-nique) sera également installé dans ce secteur.
2025 sera l’année des grands travaux.
La place de la salle démolie, un parking sera créé. Il sera enherbé. Sa construction permettra de dégager les voitures de la place Abrial et de redonner cet espace aux habitants. Pour ce faire, le bitume sera enlevé pour laisser place à une aire de jeux et à des espaces de rencontres. Le changement sera énorme. De 365 m2 d’espaces verts, on passera à plus de 1 000 m2. Auxquels il faut ajouter 595 m2 d’aire de jeux. Soit 70 % de la surface. Un cheminement piéton et cyclable sera créé pour relier les différents points du quartier. La place de la Marne sera végétalisée. Mais pas de panique pour les commerces, les places de stationnement seront conservées. Au total, les espaces verts passeront de 307 m2 à 587. Soit 40 % de la place.
Les containers enterrés seront déplacés. Et le carrefour de la rue de Jarlard sera sécurisé. “ Peut-être avec 4 stops ”, plaisante Stéphanie Guiraud-Chaumeil, la maire et présidente de l’Agglo. Au total, c’est 1,5 M d’euros que l’Agglo et la ville vont investir sur le quartier. Ce projet a été travaillé avec les habitants. De nouvelles réunions auront lieu pour définir un projet définitif en septembre.
De son côté, Tarn Habitat a travaillé en amont à l’attractivité de la place de la Marne, afin d’attirer de nouveaux commerces. 50 000 euros ont été investis pour moderniser l’espace commercial et améliorer l’accès des commerces. Aujourd’hui, on compte quatre commerces dont un va fermer. Et plusieurs locaux accueillant des services comme le Carré public... Il reste deux locaux vacants. La présidente, Florence Belou a rappelé à ce titre, que les commerces qui voulaient s’installer pouvaient bénéficier de loyer adapté et d’aides. Avis aux amateurs.
A l’été 2025, le bailleur social va procéder à une végétalisation du bas des immeubles. Cela se fera bâtiment par bâtiment en fonction des attentes des locataires. Le but de ces travaux est de recréer des espaces à vivre aux habitants. De transformer leur vie, précise Michel Franques, 1er adjoint et conseiller départemental du quartier. Ces travaux ne concernent que les extérieurs. Pour l’instant, il nées pas question de rénovation des logements. Tarn Habitat a déjà mis 2 M d’euro sur le quartier. “ Il n’y a pas d’urgence technique sur le bâtiment, souligne le directeur. Et le bailleur mène déjà de gros travaux sur la ville : Cantepau et la Tour Saint-Martin. ”
“ Cet aménagement était un engagement de campagne. Nous allons enfin annoncer aux habitants les projets qu’ils attendent ” ; a rappelé Stéphanie Guiraud-Chaumeil. En 2021, des habitants et commerçants de Lapanouse avaient fait part de leur exaspération quant à l’état d’abandon de la place de la Marne. Ce qui avait donné lieu à un échange aigre doux entre Tarn Habitat et la ville.

Le Journal de Saône et Loire | 06.03.2024
Louhans : La rue de la Grenette bientôt plus vivante grâce aux travaux d'aménagement
Après les travaux d'assainissement en fin d'année dernière, place aux travaux d'aménagement de la rue de la Grenette, à Louhans. Quels vont être les changements ? On vous explique tout.
VOIR PLUS
Voilà plusieurs jours que des agents s'activent rue de la Grenette, à Louhans. Après les travaux d'assainissement, terminés avant les fêtes de fin d'année, place aux travaux d'aménagement. Le goudron existant a été enlevé et le sol décapé avant la pose de caniveaux et de pots pour les futurs végétaux. Le béton sera ensuite coulé avant la réalisation de la bande de roulement. Un temps de séchage suivra.

Les travaux rue de la Grenette à Louhans se poursuivent. ©Chloé Riste
Plus d'espaces pour les piétons et commerçants
Vous l'aurez compris, les automobilistes devront patienter encore quelques jours avant de pouvoir emprunter de nouveau la rue de la Grenette. Les piétons, eux, ne seront pas interdits de passage.
Le nouvel aménagement de cette voie offrira “ un espace plus grand pour les piétons comme les commerçants, qui pourront installer des terrasses avec tables et chaises. La rue sera un trait d'union entre la Grande rue et la rue des Dôdanes ”, souligne le maire, Frédéric Bouchet.
Côté stationnement, les places longue durée seront remplacées par quelques arrêts minute. Des plantations seront installées le long de la rue pour une petite touche de verdure. Elles seront protégées par du mobilier, le même que celui de la place de la Libération.
“ La rue de la Grenette sera plus vivante. Quand elle sera finie, elle va apporter de l'attractivité en plein cœur de ville. Ces travaux sont le début d'un plan d'aménagement plus grand comprenant notamment les places Bertrand Thibert, de l'église et de l'hôtel de ville ”, lance le maire.

Les travaux rue de la Grenette à Louhans se poursuivent. ©Chloé Riste
Plus d'espaces pour les piétons et commerçants
Vous l'aurez compris, les automobilistes devront patienter encore quelques jours avant de pouvoir emprunter de nouveau la rue de la Grenette. Les piétons, eux, ne seront pas interdits de passage.
Le nouvel aménagement de cette voie offrira “ un espace plus grand pour les piétons comme les commerçants, qui pourront installer des terrasses avec tables et chaises. La rue sera un trait d'union entre la Grande rue et la rue des Dôdanes ”, souligne le maire, Frédéric Bouchet.
Côté stationnement, les places longue durée seront remplacées par quelques arrêts minute. Des plantations seront installées le long de la rue pour une petite touche de verdure. Elles seront protégées par du mobilier, le même que celui de la place de la Libération.
“ La rue de la Grenette sera plus vivante. Quand elle sera finie, elle va apporter de l'attractivité en plein cœur de ville. Ces travaux sont le début d'un plan d'aménagement plus grand comprenant notamment les places Bertrand Thibert, de l'église et de l'hôtel de ville ”, lance le maire.
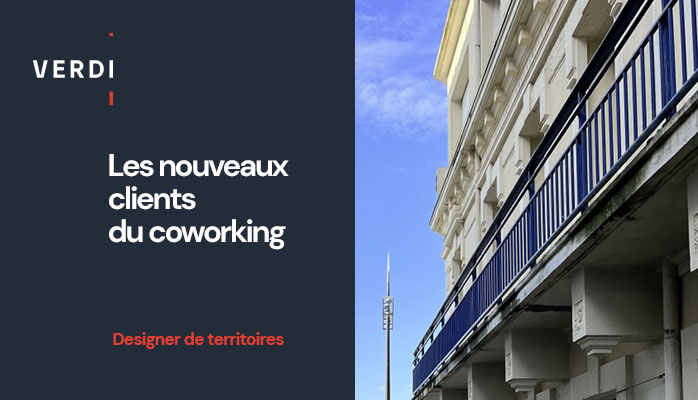
Informateur Judiciaire | 01.03.2024
Les nouveaux clients
du coworking
du coworking
Longtemps réservés aux start-up et aux travailleurs indépendants, les espaces de coworking intéressent désormais les entreprises qui y ont recours pour leurs employés en télétravail, au point qu'un coworker sur deux serait salarié. Un phénomène qui se confirme en Vendée, où le virus “pique” une clientèle de plus en plus diverse, attirée par l'avantage économique et social que représente la pratique. Témoignages.
VOIR PLUS
Niché dans l’ancien passage du Palais, sur le remblai des Sables-d’Olonne, le QG est un espace de coworking au cadre unique. “ On dispose de 300 m² situés face à la mer, s’enthousiasme Cécile Arnaud, la dirigeante du QG Corworking Sablais. L’été, on ouvre les portes pour entendre le bruit des vagues… Les coworkers peuvent sortir boire un café, déconnecter et revenir à leur tâche un peu plus inspirés. ”
Ouvert en janvier 2023, le seul espace de travail partagé privé des Sables a trouvé sa clientèle dès les vacances de février, des Parisiens en majorité. “ Des personnes ayant des postes à responsabilité, souvent dans des grands groupes et qui possèdent soit une maison secondaire, soit une maison de famille ici, précise-t-elle. Pendant que les enfants restent à la maison avec les grands-parents, ils louent un bureau à la semaine. Je me souviens avoir eu la visite d’un couple, elle directrice Europe chez Coca-Cola et lui, directeur commercial chez Mars. Avec la généralisation du télétravail, c’est devenu monnaie courante ”, assure-t-elle.
Une clientèle parisienne et internationale
“ Mais si je veux être encore plus précise, l’origine de notre toute première coworkeuse était bien plus exotique ! Il s’agissait d’une directrice d’agence de voyage basée à Bogota, en Colombie, ayant de la famille sur les Sables-d’Olonne. Depuis, chaque fois qu’elle passe en France, elle réserve un moment pour nous voir. On se donne des nouvelles, c’est un peu comme une grande famille professionnelle en fin de compte ! ” Et d’ajouter : “ Au bout d’un an, la récurrence s’est bien installée. Évidemment, on attire aussi une clientèle locale, des entrepreneurs comme des salariés en télétravail qui ont besoin de travailler hors de la maison et de se connecter socialement avec des pairs. Cela dit, des sociétés parisiennes dont les salariés sont en “ full télétravai l” il y en a beaucoup au QG ! Cela représente environ trois coworker sur dix. ”
“ De par notre situation géographique, on est l’un des rares espaces de coworking du territoire à afficher complet sur les mois d’été. Généralement, les emplois du temps de nos clients ont tendance à être de plus en plus poreux, observe-t-elle. J’ai l’impression qu’une partie ne déconnecte pas vraiment pendant les vacances… C’est d’autant plus vrai pour les profils entrepreneurs ou les postes à responsabilité. Si la météo est mauvaise, certains n’hésitent pas à laisser leurs enfants à la famille pour venir travailler chez nous. Actuellement, nous sommes en négociation avec une belle start-up parisienne dont la directrice artistique habite aux Sables-d’Olonne. Cette dernière a évoqué son souhait à sa hiérarchie de venir travailler au QG trois jours par semaine. Entre payer le matériel pour bosser à la maison et louer un espace de coworking à un collaborateur, les effets semblent bien plus bénéfiques à long terme en notre faveur. C’est une solution financière et sociale avantageuse, qui participe à la politique de marque employeur de l’entreprise. ” Elle conclut : “ Enfin, on a la chance de bénéficier d’événements sportifs exceptionnels qui jouent sur notre attractivité : je pense notamment à l’Ironman (épreuve de triathlon, NDLR). Des participants et des supporters sont venus bosser aux QG la semaine avant la course. Cette année encore, on s’attend à un pic d’occupation des lieux, notamment au moment du Vendée Globe. ”
Le coworking pour se développer ?
Parfois, le coworking est une étape pour tester un marché local et ouvrir un deuxième établissement. C’est le cas du Groupe Verdi Ingénierie (400 collaborateurs), un bureau d’études pluridisciplinaire intervenant sur des thématiques liées au bâtiment, à l’environnement et à l’eau, dont le siège social est basé dans le nord de la France. “ J’ai été recruté en 2019 pour développer l’activité sur la région sud-Pays de la Loire et nord-Aquitaine, raconte Aurélien Hermouet, responsable pôle Eau et assainissement chez Verdi Ingénierie sud-ouest. Lors de mon embauche, La Roche-sur-Yon était une cible stratégique pour le groupe. Étant seul sur la ville et les départements limitrophes, j’ai commencé à télétravailler de chez moi. Au bout d’un an, j’ai éprouvé le besoin de quitter la maison, notamment les mercredis où mes enfants étaient présents toute la journée. Au départ, j’ai poussé les portes de la Loco Numérique (espace de coworking à La Roche-sur-Yon, NDLR) mû par une volonté individuelle. Je voulais surtout tester l’ambiance pour savoir si cela me plaisait. Le coworking me permettait non seulement de retrouver des relations sociales, mais aussi d’avoir un rythme de travail plus cadré. Quand on travaille à la maison, les limites vie pro/vie perso restent floues. ” Il poursuit : “ Des mercredis, je suis passé à deux, puis trois jours par semaine. Aujourd’hui, la tendance s’est inversée et je ne fais qu’occasionnellement du télétravail. ”
Il ajoute : “ Très vite, j’ai validé avec mes supérieurs que le loyer soit pris en charge par le groupe. Au final, la Loco Numérique nous a permis de créer un siège d’établissement secondaire. Une façon de montrer à nos clients que nous sommes une entreprise locale et proche d’eux. Il poursuit : Après le Covid, l’agence a commencé à prendre de l’ampleur, une collègue de travail a été rattachée et nous avons embauché une alternante. On a pris des stagiaires, en conservant toujours ce système de coworking qui convient à tous. Cela permet vraiment de conserver des relations sociales extraprofessionnelles car au final ce sont d’autres coworkers que l’on côtoie, pas des collègues, insiste-t-il. Nous n’avons pas de dossiers en commun, nous partageons surtout des sujets de la vie courante. Pour finir, le coworking nous a servi de rampe de lancement pour nous développer tranquillement. Nous sommes trois désormais, bientôt quatre, et j’envisage de prendre des bureaux indépendants cette année. D’ici trois à quatre ans, j’espère avoir développé une petite agence de six à sept personnes qui travailleront en autonomie, tout en continuant de nous appuyer sur la puissance d’un groupe. ”
Un mode d’organisation plus agile
Une stratégie de développement inverse de celle choisie par Nutractiv, un cabinet de conseil et de formation spécialisé en nutrition pour les entreprises agroalimentaires. “ Depuis la création du cabinet en 2009, j’ai porté seule mon projet jusqu’en 2016 où mon conjoint, alors ingénieur dans l’agroalimentaire, m’a rejointe pour développer une offre digitale, raconte Bénédicte Boukandoura, la directrice de Nutractiv. À l’époque, je louais un bureau dans le centre de La Roche-sur-Yon, que je partageais avec une alternante, mais cela devenait trop petit pour trois. On a finalement signé un bail de trois ans pour un bureau privatif plus confortable à la Loco Numérique, à proximité de la gare de La Roche-sur-Yon. L’activité s’est développée et j’ai pu salarier mon alternante. Sachant qu’elle réside à Nantes, on avait opté dès 2018 pour du télétravail, deux jours par semaine. Quand le Covid est arrivé, on était déjà équipés et habitués à travailler à distance. Si bien que l’on n’a jamais repris le 100 % présentiel une fois le retour au bureau autorisé. Entre l’abonnement à Teams de Microsoft pour les visios et la messagerie instantanée interne, on a fait le choix de rester à la Loco Numérique, mais en mixant abonnement coworking et bureau privatif. On peut aussi louer des salles de réunion pour recevoir des clients en formation par exemple, c’est un peu à la carte en fonction des besoins. Je reste convaincue que la souplesse et l’agilité sont la clé d’une petite structure comme la nôtre. ”
Ouvert en janvier 2023, le seul espace de travail partagé privé des Sables a trouvé sa clientèle dès les vacances de février, des Parisiens en majorité. “ Des personnes ayant des postes à responsabilité, souvent dans des grands groupes et qui possèdent soit une maison secondaire, soit une maison de famille ici, précise-t-elle. Pendant que les enfants restent à la maison avec les grands-parents, ils louent un bureau à la semaine. Je me souviens avoir eu la visite d’un couple, elle directrice Europe chez Coca-Cola et lui, directeur commercial chez Mars. Avec la généralisation du télétravail, c’est devenu monnaie courante ”, assure-t-elle.
Une clientèle parisienne et internationale
“ Mais si je veux être encore plus précise, l’origine de notre toute première coworkeuse était bien plus exotique ! Il s’agissait d’une directrice d’agence de voyage basée à Bogota, en Colombie, ayant de la famille sur les Sables-d’Olonne. Depuis, chaque fois qu’elle passe en France, elle réserve un moment pour nous voir. On se donne des nouvelles, c’est un peu comme une grande famille professionnelle en fin de compte ! ” Et d’ajouter : “ Au bout d’un an, la récurrence s’est bien installée. Évidemment, on attire aussi une clientèle locale, des entrepreneurs comme des salariés en télétravail qui ont besoin de travailler hors de la maison et de se connecter socialement avec des pairs. Cela dit, des sociétés parisiennes dont les salariés sont en “ full télétravai l” il y en a beaucoup au QG ! Cela représente environ trois coworker sur dix. ”
“ De par notre situation géographique, on est l’un des rares espaces de coworking du territoire à afficher complet sur les mois d’été. Généralement, les emplois du temps de nos clients ont tendance à être de plus en plus poreux, observe-t-elle. J’ai l’impression qu’une partie ne déconnecte pas vraiment pendant les vacances… C’est d’autant plus vrai pour les profils entrepreneurs ou les postes à responsabilité. Si la météo est mauvaise, certains n’hésitent pas à laisser leurs enfants à la famille pour venir travailler chez nous. Actuellement, nous sommes en négociation avec une belle start-up parisienne dont la directrice artistique habite aux Sables-d’Olonne. Cette dernière a évoqué son souhait à sa hiérarchie de venir travailler au QG trois jours par semaine. Entre payer le matériel pour bosser à la maison et louer un espace de coworking à un collaborateur, les effets semblent bien plus bénéfiques à long terme en notre faveur. C’est une solution financière et sociale avantageuse, qui participe à la politique de marque employeur de l’entreprise. ” Elle conclut : “ Enfin, on a la chance de bénéficier d’événements sportifs exceptionnels qui jouent sur notre attractivité : je pense notamment à l’Ironman (épreuve de triathlon, NDLR). Des participants et des supporters sont venus bosser aux QG la semaine avant la course. Cette année encore, on s’attend à un pic d’occupation des lieux, notamment au moment du Vendée Globe. ”
Le coworking pour se développer ?
Parfois, le coworking est une étape pour tester un marché local et ouvrir un deuxième établissement. C’est le cas du Groupe Verdi Ingénierie (400 collaborateurs), un bureau d’études pluridisciplinaire intervenant sur des thématiques liées au bâtiment, à l’environnement et à l’eau, dont le siège social est basé dans le nord de la France. “ J’ai été recruté en 2019 pour développer l’activité sur la région sud-Pays de la Loire et nord-Aquitaine, raconte Aurélien Hermouet, responsable pôle Eau et assainissement chez Verdi Ingénierie sud-ouest. Lors de mon embauche, La Roche-sur-Yon était une cible stratégique pour le groupe. Étant seul sur la ville et les départements limitrophes, j’ai commencé à télétravailler de chez moi. Au bout d’un an, j’ai éprouvé le besoin de quitter la maison, notamment les mercredis où mes enfants étaient présents toute la journée. Au départ, j’ai poussé les portes de la Loco Numérique (espace de coworking à La Roche-sur-Yon, NDLR) mû par une volonté individuelle. Je voulais surtout tester l’ambiance pour savoir si cela me plaisait. Le coworking me permettait non seulement de retrouver des relations sociales, mais aussi d’avoir un rythme de travail plus cadré. Quand on travaille à la maison, les limites vie pro/vie perso restent floues. ” Il poursuit : “ Des mercredis, je suis passé à deux, puis trois jours par semaine. Aujourd’hui, la tendance s’est inversée et je ne fais qu’occasionnellement du télétravail. ”
Il ajoute : “ Très vite, j’ai validé avec mes supérieurs que le loyer soit pris en charge par le groupe. Au final, la Loco Numérique nous a permis de créer un siège d’établissement secondaire. Une façon de montrer à nos clients que nous sommes une entreprise locale et proche d’eux. Il poursuit : Après le Covid, l’agence a commencé à prendre de l’ampleur, une collègue de travail a été rattachée et nous avons embauché une alternante. On a pris des stagiaires, en conservant toujours ce système de coworking qui convient à tous. Cela permet vraiment de conserver des relations sociales extraprofessionnelles car au final ce sont d’autres coworkers que l’on côtoie, pas des collègues, insiste-t-il. Nous n’avons pas de dossiers en commun, nous partageons surtout des sujets de la vie courante. Pour finir, le coworking nous a servi de rampe de lancement pour nous développer tranquillement. Nous sommes trois désormais, bientôt quatre, et j’envisage de prendre des bureaux indépendants cette année. D’ici trois à quatre ans, j’espère avoir développé une petite agence de six à sept personnes qui travailleront en autonomie, tout en continuant de nous appuyer sur la puissance d’un groupe. ”
Un mode d’organisation plus agile
Une stratégie de développement inverse de celle choisie par Nutractiv, un cabinet de conseil et de formation spécialisé en nutrition pour les entreprises agroalimentaires. “ Depuis la création du cabinet en 2009, j’ai porté seule mon projet jusqu’en 2016 où mon conjoint, alors ingénieur dans l’agroalimentaire, m’a rejointe pour développer une offre digitale, raconte Bénédicte Boukandoura, la directrice de Nutractiv. À l’époque, je louais un bureau dans le centre de La Roche-sur-Yon, que je partageais avec une alternante, mais cela devenait trop petit pour trois. On a finalement signé un bail de trois ans pour un bureau privatif plus confortable à la Loco Numérique, à proximité de la gare de La Roche-sur-Yon. L’activité s’est développée et j’ai pu salarier mon alternante. Sachant qu’elle réside à Nantes, on avait opté dès 2018 pour du télétravail, deux jours par semaine. Quand le Covid est arrivé, on était déjà équipés et habitués à travailler à distance. Si bien que l’on n’a jamais repris le 100 % présentiel une fois le retour au bureau autorisé. Entre l’abonnement à Teams de Microsoft pour les visios et la messagerie instantanée interne, on a fait le choix de rester à la Loco Numérique, mais en mixant abonnement coworking et bureau privatif. On peut aussi louer des salles de réunion pour recevoir des clients en formation par exemple, c’est un peu à la carte en fonction des besoins. Je reste convaincue que la souplesse et l’agilité sont la clé d’une petite structure comme la nôtre. ”

Ouest France | 27.02.2024
La Châtaigneraie, entrées
de ville : des idées pour des améliorations
de ville : des idées pour des améliorations
Un temps d'échange sur le thème des entrées de ville et les moyens à mettre en œuvre pour les améliorer, les valoriser et les rendre plus attractives était proposé.
VOIR PLUS
Dans le cadre du projet Petites villes de demain, dans lequel est engagée la commune de La Châtaigneraie, la salle Félix-Lionnet accueillait, mardi 20 février, une rencontre à l’initiative de la mairie.
Les participants – la maire, des élus et l’association Action handicap Vendée – ont suivi différents ateliers, proposés et animés par Antoine Cassaigne (agence Scale) et Éloi Pasquelin (agence Verdi). Situées toutes deux aux Herbiers, ces agences sont spécialisées dans l’urbanisme, la réhabilitation et l’amélioration du cadre de vie.
Dans un premier temps, chacun, par un ou plusieurs mots, a indiqué ce qu’évoquent les entrées de ville, sud et ouest, en l’état actuel.
Pour chacune d’elles, ont été notés sur un plan, les points positifs devant être conservés ou, au contraire, ceux négatifs potentiellement à modifier et ceux qu’il serait bon de réaliser. Il a été évoqué un effort sur le fleurissement, la visibilité, la signalétique, entre autres, ainsi que des améliorations pour l’accessibilité des personnes handicapées.
Pour finir, ont été choisies, parmi plusieurs photos, celles qui représentent le mieux ce qui est imaginé pour La Châtaigneraie.
Après un temps de mise en commun, les réponses des deux groupes se sont recoupées très largement. Des propositions seront prochainement présentées par les agences.
Les participants – la maire, des élus et l’association Action handicap Vendée – ont suivi différents ateliers, proposés et animés par Antoine Cassaigne (agence Scale) et Éloi Pasquelin (agence Verdi). Situées toutes deux aux Herbiers, ces agences sont spécialisées dans l’urbanisme, la réhabilitation et l’amélioration du cadre de vie.
Dans un premier temps, chacun, par un ou plusieurs mots, a indiqué ce qu’évoquent les entrées de ville, sud et ouest, en l’état actuel.
Pour chacune d’elles, ont été notés sur un plan, les points positifs devant être conservés ou, au contraire, ceux négatifs potentiellement à modifier et ceux qu’il serait bon de réaliser. Il a été évoqué un effort sur le fleurissement, la visibilité, la signalétique, entre autres, ainsi que des améliorations pour l’accessibilité des personnes handicapées.
Pour finir, ont été choisies, parmi plusieurs photos, celles qui représentent le mieux ce qui est imaginé pour La Châtaigneraie.
Après un temps de mise en commun, les réponses des deux groupes se sont recoupées très largement. Des propositions seront prochainement présentées par les agences.
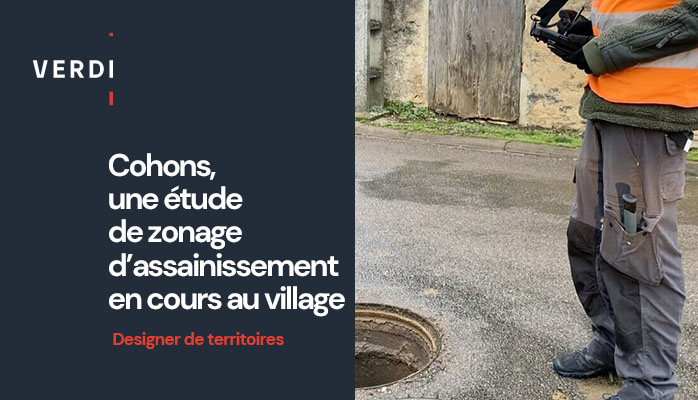
Le Journal de la Haute-Marne | 23.02.2024
Cohons : Une étude de zonage d'assainissement en cours au village
Cette année, la commune réalise une étude de zonage d'assainissement afin d'identifier les zones d'assainissement collectif et non collectif sur son territoire. Une première réunion publique est prévue ce vendredi 23 février, en soirée.
VOIR PLUS
L’étude de zonage d’assainissement est un document réglementaire et obligatoire permet aux communes de délimiter, après enquête publique, un zonage d’assainissement avec des zones d’assainissement collectif et des zones d’assainissement non collectif (ANC).

Géolocalisation des ouvrages sur SIG
L’étude, qui a débuté en fin d’année 2023, est réalisée par le bureau d’études Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté. Elle va se dérouler sur une période d’un an. La réunion de lancement de cette étude s’est tenue en mairie, le 14 décembre, en présence des membres du conseil municipal, du Département de la Haute-Marne et de la DDT (Direction départementale des territoires). L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse est également partenaire de l’étude.
Géolocalisation et plans à l’échelle
Différentes phases seront réalisées par le cabinet d’études Verdi en 2024 avec notamment des phases de terrain qui permettront de caractériser les réseaux d’assainissement existants aussi bien sur le domaine public que sur le domaine privé.
Dès fin décembre, une reconnaissance des éléments du réseau (tuyaux, regards, fontaines), de l’état du réseau, du cheminement des eaux a été réalisée par SIG avec une prise des profondeurs. A cet effet, 120 regards, 89 grilles avaloirs et 18 apports d’eaux claires (fontaines, sources, branchements apportant de l’eau) ont été localisés spatialement et géographiquement. Début février, une géolocalisation en classe A a complété l’ensemble des ouvrages du réseau avec les exutoires. Des plans à l’échelle sont ainsi effectifs tout comme une cartographie du réseau géolocalisé et conforme au cahier des charges du Sded 52.
 La réseau géolocalisé est conforme au cahier des charges du Sded 52
La réseau géolocalisé est conforme au cahier des charges du Sded 52
Des visites sur les propriétés
Sur les prochaines semaines, des visites parcellaires chez les habitants se tiendront afin de dresser, en présence des propriétaires, un état des lieux des installations d’assainissement existantes au niveau de chaque maison et bâtiment. Six journées sont prévues à cet effet suite à des créneaux d’inscription selon les disponibilités.
L’étude permettra de définir différents scénarios avec comparatif technico-économique qui permettra à la collectivité de choisir la meilleure solution pour mettre en conformité l’assainissement à l’échelle de l’ensemble du territoire communal. Les réunions publiques, au cours de cette étude, faciliteront les réponses aux différentes questions des habitants.

Géolocalisation des ouvrages sur SIG
L’étude, qui a débuté en fin d’année 2023, est réalisée par le bureau d’études Verdi Ingénierie Bourgogne Franche-Comté. Elle va se dérouler sur une période d’un an. La réunion de lancement de cette étude s’est tenue en mairie, le 14 décembre, en présence des membres du conseil municipal, du Département de la Haute-Marne et de la DDT (Direction départementale des territoires). L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse est également partenaire de l’étude.
Géolocalisation et plans à l’échelle
Différentes phases seront réalisées par le cabinet d’études Verdi en 2024 avec notamment des phases de terrain qui permettront de caractériser les réseaux d’assainissement existants aussi bien sur le domaine public que sur le domaine privé.
Dès fin décembre, une reconnaissance des éléments du réseau (tuyaux, regards, fontaines), de l’état du réseau, du cheminement des eaux a été réalisée par SIG avec une prise des profondeurs. A cet effet, 120 regards, 89 grilles avaloirs et 18 apports d’eaux claires (fontaines, sources, branchements apportant de l’eau) ont été localisés spatialement et géographiquement. Début février, une géolocalisation en classe A a complété l’ensemble des ouvrages du réseau avec les exutoires. Des plans à l’échelle sont ainsi effectifs tout comme une cartographie du réseau géolocalisé et conforme au cahier des charges du Sded 52.
 La réseau géolocalisé est conforme au cahier des charges du Sded 52
La réseau géolocalisé est conforme au cahier des charges du Sded 52Des visites sur les propriétés
Sur les prochaines semaines, des visites parcellaires chez les habitants se tiendront afin de dresser, en présence des propriétaires, un état des lieux des installations d’assainissement existantes au niveau de chaque maison et bâtiment. Six journées sont prévues à cet effet suite à des créneaux d’inscription selon les disponibilités.
L’étude permettra de définir différents scénarios avec comparatif technico-économique qui permettra à la collectivité de choisir la meilleure solution pour mettre en conformité l’assainissement à l’échelle de l’ensemble du territoire communal. Les réunions publiques, au cours de cette étude, faciliteront les réponses aux différentes questions des habitants.

Ouest France | 21.02.2024
Mouilleron-Saint-Germain : La population réfléchit à l'aména-
gement des entrées de ville
gement des entrées de ville
Mardi 20 février 2024, un atelier collaboratif s'est tenu à la salle du Chêne-Vert de Mouilleron-Saint-Germain (Vendée). Le but : concerter et faire réfléchir la population à l'aménagement futur des entrées de la commune, dans le cadre du programme Petites villes de demain.
VOIR PLUS
Depuis peu, Mouilleron-Saint-Germain (Vendée) propose des ateliers participatifs pour que les habitants réfléchissent à l’amélioration de la commune. Mardi soir, la réflexion était axée autour de l’aménagement des entrées de ville, sur la D949 bis : une vingtaine de personnes avait répondu à l’invitation.
Des ateliers par groupes sur les vues aériennes de chaque entrée de la commune ont permis de partager les points forts et problématiques rencontrés en fonction du mode de déplacement : à vélo, à pied, en voiture. “ Par un code couleur, nous mettrons en avant les dangers et problématiques en rouge, les éléments satisfaisants à conserver en vert, les souhaits pour le futur en jaune et les autres remarques en bleu ”, explique Charles Lopez, du cabinet Verdi.

Mardi 20 février 2024, à la salle du Chêne-Vert, en petits groupes, les habitants de Mouilleron-Saint-Germain (Vendée) ont planché ensemble sur l’aménagement futur des entrées de la commune.
Prioriser la sécurité
Au fil de la soirée, la réflexion sur la sécurité est restée primordiale sur cet axe très passager. “ Il y a un réel manque de sécurité pour se promener à pied ou à vélo ”, note un cycliste, alors qu’une autre habitante souligne “ l’étroitesse, voire l’absence des trottoirs ” “ La circulation est trop rapide et le stationnement insuffisant ”, regrette un autre. Malgré tout, certains secteurs ont été désignés comme des zones de circulation sans risque et certains aménagements routiers, efficaces pour faire ralentir les véhicules. Le manque d’accessibilité a également été évoqué.
Attirer vers le centre-bourg
De même, le manque de signalétique vers le centre-bourg a été plusieurs fois souligné. “ Il faut attirer ceux qui traversent cet axe à dévier vers nos commerces ”, pointe un habitant. La beauté de l’entrée, du côté des moulins et du domaine Saint-Sauveur, ainsi que l’aménagement du rond-point ont été remarqués.
Un atelier photo langage a aidé à choisir les axes prioritaires futurs des entrées de ville. À l’aide de clichés, les habitants ont souhaité prioriser “ un paysage ouvert, avec peu de bâtiments, un patrimoine visible, une entrée végétalisée et fonctionnelle, de grands alignements d’arbres, des espaces différenciés pour les usagers et une entrée avec des activités économiques ”, synthétise Axel Piet, du cabinet Scale.
Ces retours seront croisés avec les idées des cabinets d’étude afin de faire un bilan et proposer des scénarios d’aménagement aux deux entrées de la commune. Valentin Josse, maire, a remercié les participants pour leur engagement, leurs idées et leur participation. Nous allons continuer à améliorer notre qualité de vie, notre sécurité et la mobilité à Mouilleron-Saint-Germain.
Des ateliers par groupes sur les vues aériennes de chaque entrée de la commune ont permis de partager les points forts et problématiques rencontrés en fonction du mode de déplacement : à vélo, à pied, en voiture. “ Par un code couleur, nous mettrons en avant les dangers et problématiques en rouge, les éléments satisfaisants à conserver en vert, les souhaits pour le futur en jaune et les autres remarques en bleu ”, explique Charles Lopez, du cabinet Verdi.

Mardi 20 février 2024, à la salle du Chêne-Vert, en petits groupes, les habitants de Mouilleron-Saint-Germain (Vendée) ont planché ensemble sur l’aménagement futur des entrées de la commune.
Prioriser la sécurité
Au fil de la soirée, la réflexion sur la sécurité est restée primordiale sur cet axe très passager. “ Il y a un réel manque de sécurité pour se promener à pied ou à vélo ”, note un cycliste, alors qu’une autre habitante souligne “ l’étroitesse, voire l’absence des trottoirs ” “ La circulation est trop rapide et le stationnement insuffisant ”, regrette un autre. Malgré tout, certains secteurs ont été désignés comme des zones de circulation sans risque et certains aménagements routiers, efficaces pour faire ralentir les véhicules. Le manque d’accessibilité a également été évoqué.
Attirer vers le centre-bourg
De même, le manque de signalétique vers le centre-bourg a été plusieurs fois souligné. “ Il faut attirer ceux qui traversent cet axe à dévier vers nos commerces ”, pointe un habitant. La beauté de l’entrée, du côté des moulins et du domaine Saint-Sauveur, ainsi que l’aménagement du rond-point ont été remarqués.
Un atelier photo langage a aidé à choisir les axes prioritaires futurs des entrées de ville. À l’aide de clichés, les habitants ont souhaité prioriser “ un paysage ouvert, avec peu de bâtiments, un patrimoine visible, une entrée végétalisée et fonctionnelle, de grands alignements d’arbres, des espaces différenciés pour les usagers et une entrée avec des activités économiques ”, synthétise Axel Piet, du cabinet Scale.
Ces retours seront croisés avec les idées des cabinets d’étude afin de faire un bilan et proposer des scénarios d’aménagement aux deux entrées de la commune. Valentin Josse, maire, a remercié les participants pour leur engagement, leurs idées et leur participation. Nous allons continuer à améliorer notre qualité de vie, notre sécurité et la mobilité à Mouilleron-Saint-Germain.
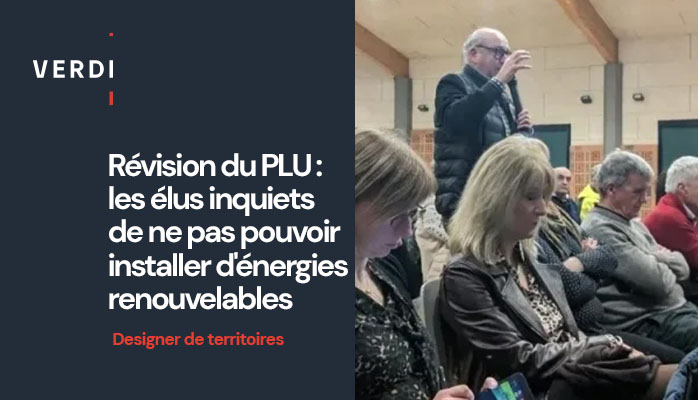
La Voix de l’Ain | 10.02.2024
Haut-Bugey, les élus inquiets de ne pas pouvoir installer d'énergies renouvelables
Plusieurs élus ont interpellé le président de l'Agglo Michel Mourlevat et Annie Escoda, vice-présidente, sur les nouvelles réglementations qui devraient être votées à la fin de l'année 2024 par les élus communautaires.
VOIR PLUS
“ Aujourd'hui, Il y a une loi qui dit qu'on doit diviser par deux le potentiel constructible de nos communes ”, explique Annie Escoda. Vice-présidente de l’Aménagement de l'espace et de la stratégie territoriale d'Haut-Bugey Agglomération (HBA). Jeudi 1er février, les habitants étaient conviés pour évoquer la modification du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et du Schéma de cohérence territorial (SCoT) pour rentrer dans les normes de la loi Climat et résilience visant zéro artificialisation nette. Si cette réunion était l'occasion d'expliquer aux particuliers les effets de cette loi, nombreux d'entre eux ont Quitté la salle quand Annie Escoda a déclaré qu'ils n'évoqueraient pas les cas particuliers. A contrario, les élus des communes rurales ont profité de ce moment d'échanges pour faire part de leurs inquiétudes. Et ce, notamment, sur l'installation des énergies renouvelables. “ Pourquoi avez-vous décidé dans ce Projet d'aménagement et de développement durable (PADD), qu’il n'y aurait pas l'extension de l'énergie éolien ? ”, a questionné Thierry Pernod, maire d'Échallon. Ce à quoi Annie Escoda a répondu : “ la question a été travaillée dans les ateliers de révision du SCoT. ” Face aux indignations sur un manque de concertation, elle a poursuivi : “ A l’époque, quand on la fait, la commune n'avait pas la compétence, l'intercommunalité l'avait. Donc ça a été voté en intercommunalité, avec le projet d'aménagement stratégique (PAS) du SCoT. ”
Mais pour Thierry Pernod cette décision n'est pas sans conséquences : “ On a des communes rurales très impactées par l'état sanitaire de nos forêts. En 2022, l’Office national des forêts (ONF) nous promettait environ 240 000 € de revenus forestiers. Aujourd’hui, si on arrive a100 000 €, ça sera beau. Le fait de pouvoir investir dans diverses énergies, peut permettre à ces communes de mettre du beurre dans les épinards. ” Au nom de l’Agglomération la vice-présidente a tenu à rappeler que “ HBA n'est pas responsable de tout, elle n’est pas responsable des forêts qui sont en train de dépérir. ” complété par le président de l'agglomération Michel Mourlevat : « De nombreuses communes sont impactées par nos forêts malades. C'est quelque chose qui doit se réfléchir. Mais Il y a la loi. J'ai parlé à l’ancienne ministre de la transition écologique de cette ambiguïté : l'État dit aux communes de s'occuper des zones de développement d’énergies renouvelables ; mais le débat doit se faire au niveau de l’Agglo. Il y a déjà un hiatus à mon sens. ”
La propriété n’a plus le même sens que ce que l’on a connu
Toujours sur les énergies renouvelables, le maire de Matafelon-Granges, Jean-Pierre Duparchy, a questionné les intervenants sur la possibilité de les installer sur des terrains en zone naturelle. “ Ça va dépendre du lieu ” a répliqué Annie Escoda. Guillaume Tempelaere qui travaille en concertation avec HBA sur le dossier, ajoute : “ Il y a une doctrine assez fixe, qui n’interdit pas les projets photovoltaïques, ni le développement en zone naturelle, mais c'est sous certaines conditions. Par exemple, dans les· anciennes friches en zone naturelle, si on justifie qu’elles n’ont plus du tout le caractère agricole et pas de valeur écologique, le projet pourrait être autorisé. ”
“ Je suis surpris que dans tout ce qui a été affiché, il n’y ait rien sur la Combe du Val ” a interpelé Hector Doy, ancien maire de Vieu-d'izenave. Annie Escoda a déclaré : “ Il n'y a pas une commune spécifique. On est sur un territoire. ” Cette dernière a rappelé que toutes les communes avaient reçues deux fois en 2023. Elle a tenu à souligner : “ On a essayé de trouver les meilleures solutions pour chaque commune. Ce n’est pas évident. La propriété n’a plus le même sens que ce que l’on a connu. ”
Pour conclure le débat Mlchel Mourlevat a indiqué : “ Au fond, il n'y a pas de raisons que l’on soit contre le fait de stopper l’étalement urbain, ce qui me dérange c’est que ces lois soient votées par des Parisiens. Il faut une vraie loi de décentralisation que fon puisse appliquer différemment ces règles dans les grandes villes que sur nos territoires. Quand on survole notre territoire, il est vert. L’étalement urbain chez nous est très limité. ”
Mais pour Thierry Pernod cette décision n'est pas sans conséquences : “ On a des communes rurales très impactées par l'état sanitaire de nos forêts. En 2022, l’Office national des forêts (ONF) nous promettait environ 240 000 € de revenus forestiers. Aujourd’hui, si on arrive a100 000 €, ça sera beau. Le fait de pouvoir investir dans diverses énergies, peut permettre à ces communes de mettre du beurre dans les épinards. ” Au nom de l’Agglomération la vice-présidente a tenu à rappeler que “ HBA n'est pas responsable de tout, elle n’est pas responsable des forêts qui sont en train de dépérir. ” complété par le président de l'agglomération Michel Mourlevat : « De nombreuses communes sont impactées par nos forêts malades. C'est quelque chose qui doit se réfléchir. Mais Il y a la loi. J'ai parlé à l’ancienne ministre de la transition écologique de cette ambiguïté : l'État dit aux communes de s'occuper des zones de développement d’énergies renouvelables ; mais le débat doit se faire au niveau de l’Agglo. Il y a déjà un hiatus à mon sens. ”
La propriété n’a plus le même sens que ce que l’on a connu
Toujours sur les énergies renouvelables, le maire de Matafelon-Granges, Jean-Pierre Duparchy, a questionné les intervenants sur la possibilité de les installer sur des terrains en zone naturelle. “ Ça va dépendre du lieu ” a répliqué Annie Escoda. Guillaume Tempelaere qui travaille en concertation avec HBA sur le dossier, ajoute : “ Il y a une doctrine assez fixe, qui n’interdit pas les projets photovoltaïques, ni le développement en zone naturelle, mais c'est sous certaines conditions. Par exemple, dans les· anciennes friches en zone naturelle, si on justifie qu’elles n’ont plus du tout le caractère agricole et pas de valeur écologique, le projet pourrait être autorisé. ”
“ Je suis surpris que dans tout ce qui a été affiché, il n’y ait rien sur la Combe du Val ” a interpelé Hector Doy, ancien maire de Vieu-d'izenave. Annie Escoda a déclaré : “ Il n'y a pas une commune spécifique. On est sur un territoire. ” Cette dernière a rappelé que toutes les communes avaient reçues deux fois en 2023. Elle a tenu à souligner : “ On a essayé de trouver les meilleures solutions pour chaque commune. Ce n’est pas évident. La propriété n’a plus le même sens que ce que l’on a connu. ”
Pour conclure le débat Mlchel Mourlevat a indiqué : “ Au fond, il n'y a pas de raisons que l’on soit contre le fait de stopper l’étalement urbain, ce qui me dérange c’est que ces lois soient votées par des Parisiens. Il faut une vraie loi de décentralisation que fon puisse appliquer différemment ces règles dans les grandes villes que sur nos territoires. Quand on survole notre territoire, il est vert. L’étalement urbain chez nous est très limité. ”

Construction 21 | 08.02.2024 | Eric Larrey
Inégalités environnementales et sociales dans les arrondissements de Paris
La densification des villes et des métropoles interroge sur la capacité à maintenir un certain niveau d’accès à de la végétation de proximité, si nécessaire à la qualité de vie et à la biodiversité. Le développement urbain implique des populations aux profils variés et peut, si l'on n'y prend garde, générer des inégalités environnementales qui se surajouteraient à des inégalités socio-économiques. Tentons d’étudier ce qu’il en est avec Paris, parangon de densité urbaine, dont 80% de sa population dispose de moins de 30% d’espaces végétalisés de proximité.
VOIR PLUS


 Designer de territoires
Designer de territoires Suivez-nous sur Linkedin
Suivez-nous sur Linkedin