
Ici | 16.09.2025
Grâce à une nouvelle station d'épuration, la rivière n'est plus polluée
La communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle a inauguré fin août une nouvelle station d'épuration à Montfort-sur-Risle (Eure). La précédente, qui datait de 1973, était obsolète et certaines de cinq communes raccordées ne polluent désormais plus la rivière.
VOIR PLUS
Cette nouvelle station d'épuration à Montfort-sur-Risle (Eure), le secteur en avait bien besoin car " la situation de l'assainissement devenait problématique ", confie Maxime Tavernier, le responsable du service Eau et Assainissement de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle. La station, inaugurée le 29 août 2025, a coûté 11 millions d'euros hors taxe. Elle a une capacité de 3.350 équivalents habitants contre 1.500 pour la précédente qui avait plus de cinquante ans.

Philippe Marie, Maxime Tavernier et Jean-Luc Barre devant le bassin d'aération de la station d'épuration Val de Risle à Montfort-sur-Risle (Eure) © Radio France, Laurent Philippot
Elle traite les eaux usées de cinq communes : Appeville-Annebault, Glos-sur-Risle, Montfort-sur-Risle, Pont-Authou, Saint-Philbert-sur-Risle et “ sur les cinq communes, on avait deux communes avec des déversements directs à la Risle ”, explique le technicien.
Est-ce à dire que lorsqu'un habitant tirait la chasse d'eau chez lui, tout partait directement dans la rivière ? “ Sur certaines communes et maisons, oui ”, concède Philippe Marie, maire du Perrey et vice-président de la communauté de communes en charge du dossier, “ mais pas partout. Il y avait une petite station, un point de traitement, mais qui n’avait plus la capacité de ni de tout retenir ni de rejeter des eaux propres, avec un système de filtration qui n'était plus adapté et donc des rejets. Pas de chasse d'eau polluée dans le milieu, ce qui est inadmissible de nos jours ”.

Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur un des bâtiments de la station d'épuration © Radio France, Laurent Philippot
Le maire de Montfort-sur-Risle est ravi de cet équipement flambant neuf car “ on avait un problème de boues, les boues étaient liquides et puis les boues étaient séchées sur place. On a essayé de s'en débarrasser auprès des cultivateurs, mais ce n'était pas bien. J'espère que maintenant ça va aller ”, avance Jean-Luc Barre.
Un parcours pédagogique
L'ancienne station d'épuration de Montfort-sur-Risle était déjà auparavant une des sorties annuelles d'une classe du collège, la nouvelle devrait susciter leur intérêt. Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit d'un bâtiment et la communauté de communes veut ouvrir le site au plus grand nombre. Le portail d'entrée a été déplacé de quelques mètres et un chemin piétonnier a été créé tout autour de l'équipement. Des nichoirs à martinets noirs, à hirondelles des rivières ou à chauves-souris ont été installés.

Du haut du toit du bâtiment principal, on aperçoit des vaches qui s'abreuvent dans la Risle © Radio France, Laurent Philippot
Sur ce lit mineur de la Risle, une centrale hydroélectrique a été supprimée et une passe à poissons a été créée, “ une des plus grandes de France en réalisation avec une remontée des truites de mer ”, se réjouit Philippe Marie, “ la température est adaptée à la truite de mer et cette passe a permis de voir précisément que les poissons attendaient pour remonter. On a pu les compter. Il a une énorme remontée de poissons. On se devait de rejeter des eaux de bonne qualité pour que le processus aille jusqu'au bout et que la reproduction puisse se faire convenablement ”.

Philippe Marie, Maxime Tavernier et Jean-Luc Barre devant le bassin d'aération de la station d'épuration Val de Risle à Montfort-sur-Risle (Eure) © Radio France, Laurent Philippot
Elle traite les eaux usées de cinq communes : Appeville-Annebault, Glos-sur-Risle, Montfort-sur-Risle, Pont-Authou, Saint-Philbert-sur-Risle et “ sur les cinq communes, on avait deux communes avec des déversements directs à la Risle ”, explique le technicien.
Est-ce à dire que lorsqu'un habitant tirait la chasse d'eau chez lui, tout partait directement dans la rivière ? “ Sur certaines communes et maisons, oui ”, concède Philippe Marie, maire du Perrey et vice-président de la communauté de communes en charge du dossier, “ mais pas partout. Il y avait une petite station, un point de traitement, mais qui n’avait plus la capacité de ni de tout retenir ni de rejeter des eaux propres, avec un système de filtration qui n'était plus adapté et donc des rejets. Pas de chasse d'eau polluée dans le milieu, ce qui est inadmissible de nos jours ”.

Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur un des bâtiments de la station d'épuration © Radio France, Laurent Philippot
Le maire de Montfort-sur-Risle est ravi de cet équipement flambant neuf car “ on avait un problème de boues, les boues étaient liquides et puis les boues étaient séchées sur place. On a essayé de s'en débarrasser auprès des cultivateurs, mais ce n'était pas bien. J'espère que maintenant ça va aller ”, avance Jean-Luc Barre.
Un parcours pédagogique
L'ancienne station d'épuration de Montfort-sur-Risle était déjà auparavant une des sorties annuelles d'une classe du collège, la nouvelle devrait susciter leur intérêt. Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit d'un bâtiment et la communauté de communes veut ouvrir le site au plus grand nombre. Le portail d'entrée a été déplacé de quelques mètres et un chemin piétonnier a été créé tout autour de l'équipement. Des nichoirs à martinets noirs, à hirondelles des rivières ou à chauves-souris ont été installés.

Du haut du toit du bâtiment principal, on aperçoit des vaches qui s'abreuvent dans la Risle © Radio France, Laurent Philippot
Sur ce lit mineur de la Risle, une centrale hydroélectrique a été supprimée et une passe à poissons a été créée, “ une des plus grandes de France en réalisation avec une remontée des truites de mer ”, se réjouit Philippe Marie, “ la température est adaptée à la truite de mer et cette passe a permis de voir précisément que les poissons attendaient pour remonter. On a pu les compter. Il a une énorme remontée de poissons. On se devait de rejeter des eaux de bonne qualité pour que le processus aille jusqu'au bout et que la reproduction puisse se faire convenablement ”.
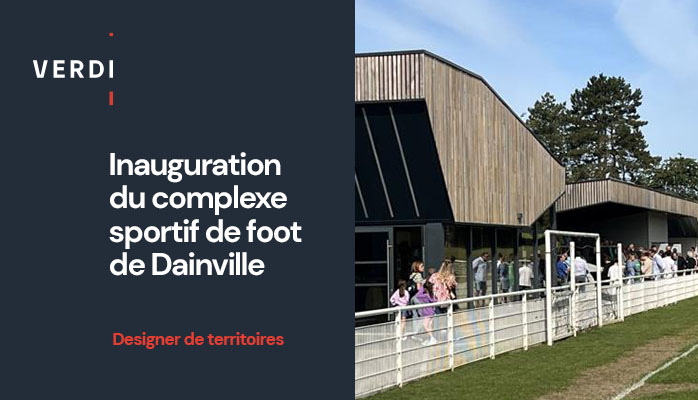
La Voix du Nord | 07.09.2025
Inauguration du complexe sportif de foot de Dainville
Ce samedi matin a été inauguré le complexe sportif de football (club-house, vestiaires, tribune). L’occasion de rendre hommage à André Arbinet, un bénévole du club pendant 60 ans.
VOIR PLUS
Malgré une santé chancelante, il a tenu à être présent. Entouré par sa famille. Samedi matin, André Arbinet a été mis à l’honneur à l’occasion de l’inauguration du complexe sportif de football de Dainville et de son club-house. L’homme comptabilise soixante années de bénévolat (17 ans au RCA et 43 ans au club de foot de Dainville). Cet ancien boulanger est un exemple. Il a consacré son temps libre à aider les jeunes du club dainvillois qui le surnommait affectueusement « Monsieur Banga » du nom de cette ancienne boisson à l’orange aujourd’hui disparue. Généreux, il aimait apporter chaque semaine une tarte pour les petits du club. Tour à tour dirigeant, accompagnateur, arbitre de touche, il assiste à tous les matchs du club quand il le peut. Il en est aujourd’hui le président d’honneur. Et depuis samedi, son nom est apposé sur le nouveau club-house du complexe sportif. Une juste récompense pour ces années d’engagement.

Le complexe sportif a été inauguré samedi matin. Photo Benjamin Dubrulle
En service depuis le début de l’année, le complexe sportif de foot a officiellement été inauguré samedi matin. Ce vaste projet a été lancé au début du précédent mandat comme l’a rappelé la maire Françoise Rossignol. « Il y avait de gros problèmes d’assainissement, tous les dimanches, on devait déboucher les lavabos. C’était un projet complexe à mener mais indispensable car l’équipement était vieillissant. Le club-house était trop petit et les vestiaires étaient dépassés. »
Intégrer au centre vert
Le chantier n’a pas été simple à mener, les entreprises n’étant pas fans de travailler sur la réhabilitation d’un bâtiment. Il y avait aussi des contraintes : il fallait que le projet s’intègre au centre vert avec l’absence de clôture par exemple. Le nombre de vestiaires est passé de quatre à six conséquences de la montée en puissance de la section féminine du club. Bon point : des panneaux photovoltaïques en autoconsommation collective et une moquette solaire pour la production d’eau chaude ont été installés.

Le nombre de vestiaire est passé de quatre à six. Photo Benjamin Dubrulle
Les travaux, commencés en décembre 2023, ont été achevés en janvier 2025, pour un montant total de 1 549 500€ HT, incluant les subventions de l’État à 207 500€, du Département du Pas-de-Calais à 300 000€, de la communauté urbaine d’Arras à 277 000€ et de la Fédération française de football à 30 000€.

Le complexe sportif a été inauguré samedi matin. Photo Benjamin Dubrulle
En service depuis le début de l’année, le complexe sportif de foot a officiellement été inauguré samedi matin. Ce vaste projet a été lancé au début du précédent mandat comme l’a rappelé la maire Françoise Rossignol. « Il y avait de gros problèmes d’assainissement, tous les dimanches, on devait déboucher les lavabos. C’était un projet complexe à mener mais indispensable car l’équipement était vieillissant. Le club-house était trop petit et les vestiaires étaient dépassés. »
Intégrer au centre vert
Le chantier n’a pas été simple à mener, les entreprises n’étant pas fans de travailler sur la réhabilitation d’un bâtiment. Il y avait aussi des contraintes : il fallait que le projet s’intègre au centre vert avec l’absence de clôture par exemple. Le nombre de vestiaires est passé de quatre à six conséquences de la montée en puissance de la section féminine du club. Bon point : des panneaux photovoltaïques en autoconsommation collective et une moquette solaire pour la production d’eau chaude ont été installés.

Le nombre de vestiaire est passé de quatre à six. Photo Benjamin Dubrulle
Les travaux, commencés en décembre 2023, ont été achevés en janvier 2025, pour un montant total de 1 549 500€ HT, incluant les subventions de l’État à 207 500€, du Département du Pas-de-Calais à 300 000€, de la communauté urbaine d’Arras à 277 000€ et de la Fédération française de football à 30 000€.
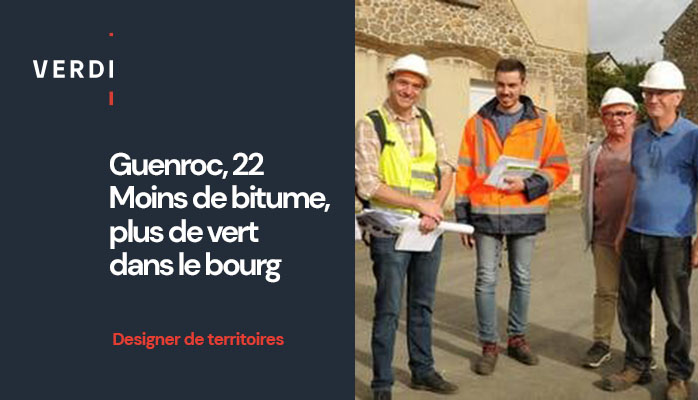
Ouest-France | 05.09.2025
Guenroc. Moins de bitume, plus de vert dans le bourg
Les travaux d’aménagement de la rue principale du bourg sont engagés. Cinq semaines sont prévues : trois semaines de préparation, une pour la réalisation de l’enrobé et une pour les finitions
VOIR PLUS
“ Cet aménagement urbain est engagé pour déminéraliser une partie de la rue. On enlève 20 % du bitume qui est remplacé par des espaces aménagés, engazonnés, avec la possibilité de stationnements sur certains endroits. En plus, il y aura des plantations ”, indique Tanguy Roquier, conseiller municipal.
Créer un bourg jardin
“ L’idée, c’est de redonner plus de verdure et permettre à l’eau pluviale de s’infiltrer sans aller dans les réseaux. C’est la désimperméabilisation des sols. ”
Jonas Gouya, paysagiste à l’atelier Ster, précise la finalité du projet : “ La philosophie est de conserver un maximum de l’existant pour un budget contraint de 45 € HT le m². C’est deux fois moins cher que dans un bourg classique, grâce au Département qui encourage ce genre de projets en prenant en charge l’enrobé. L’idée est de créer un bourg jardin. On désimperméabilise et on végétalise pour mettre en valeur le patrimoine. ”
Le projet global est de 130 000 € HT et est subventionné à 80 %. “ C’est un projet simple, avec des rétrécissements de voies entre la salle des fêtes et la mairie. On a des subventions du Fonds vert, de la Région, de l’État, de Dinan agglo et le Département prend à sa charge l’enrobé ”, précise le maire, Roger Costard.
Créer un bourg jardin
“ L’idée, c’est de redonner plus de verdure et permettre à l’eau pluviale de s’infiltrer sans aller dans les réseaux. C’est la désimperméabilisation des sols. ”
Jonas Gouya, paysagiste à l’atelier Ster, précise la finalité du projet : “ La philosophie est de conserver un maximum de l’existant pour un budget contraint de 45 € HT le m². C’est deux fois moins cher que dans un bourg classique, grâce au Département qui encourage ce genre de projets en prenant en charge l’enrobé. L’idée est de créer un bourg jardin. On désimperméabilise et on végétalise pour mettre en valeur le patrimoine. ”
Le projet global est de 130 000 € HT et est subventionné à 80 %. “ C’est un projet simple, avec des rétrécissements de voies entre la salle des fêtes et la mairie. On a des subventions du Fonds vert, de la Région, de l’État, de Dinan agglo et le Département prend à sa charge l’enrobé ”, précise le maire, Roger Costard.

L’Éveil de Pont-Audemer | 02.09.2025
Une nouvelle station d'épuration met fin à la pollution de la rivière
À Saint-Philbert-sur-Risle, la nouvelle station d'épuration a été inaugurée ce 29 août 2025. Avec cet équipement, la vallée de la Risle est aux normes de traitement des eaux usées.
VOIR PLUS
« Tout partait à la Risle ! Eaux usées, eaux pluviales… Engendrant une pollution terrible pour le cours d’eau, pour sa faune, sa flore, ses rives et ses habitants. » Comme l’a rappelé Francis Courel, ce vendredi 29 août 2025 à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle station d’épuration de Saint-Philbert-sur-Risle (Eure), on partait de loin. Pour mémoire, le bourg d’Appeville-dit-Annebault n’était relié à aucun réseau de traitement des eaux usées et la petite station d’épuration de Pont-Authou était défaillante.
Mais désormais, les normes pour le traitement des eaux usées sont respectées dans la vallée de la Risle.
Dimensionné pour 3 500 habitants
Le nouvel équipement, en fonctionnement depuis la fin 2024, dessert cinq communes : Montfort-sur-Risle, Saint-Philbert-sur-Risle, Glos-sur-Risle, Appeville-dit-Annebault et Pont-Authou. La station est dimensionnée pour un équivalent de 3 350 habitants. C’est plus du double de la capacité de l’ancienne station (1 500 habitants) et cela permet d’anticiper une urbanisation nouvelle dans la vallée.
Outre la station, c’est une rénovation des canalisations qui a été opérée. Une enveloppe globale de plus de 12 millions d’euros a été consentie pour ces chantiers, dont 70 % via l’Agence de l’eau et 1,35 million via le Département.
Réutiliser l’eau traitée
Au cours de l’inauguration, Francis Courel a dévoilé une ambition de la Comcom : réutiliser l’eau traitée pour la diriger vers l’irrigation, l’arrosage, l’industrie ou encore le nettoyage des voiries. Cela pourrait faire décroître le prélèvement dans la nappe phréatique, ce qui n’est pas rien en période de sécheresse.
Mais désormais, les normes pour le traitement des eaux usées sont respectées dans la vallée de la Risle.
Dimensionné pour 3 500 habitants
Le nouvel équipement, en fonctionnement depuis la fin 2024, dessert cinq communes : Montfort-sur-Risle, Saint-Philbert-sur-Risle, Glos-sur-Risle, Appeville-dit-Annebault et Pont-Authou. La station est dimensionnée pour un équivalent de 3 350 habitants. C’est plus du double de la capacité de l’ancienne station (1 500 habitants) et cela permet d’anticiper une urbanisation nouvelle dans la vallée.
Outre la station, c’est une rénovation des canalisations qui a été opérée. Une enveloppe globale de plus de 12 millions d’euros a été consentie pour ces chantiers, dont 70 % via l’Agence de l’eau et 1,35 million via le Département.
Réutiliser l’eau traitée
Au cours de l’inauguration, Francis Courel a dévoilé une ambition de la Comcom : réutiliser l’eau traitée pour la diriger vers l’irrigation, l’arrosage, l’industrie ou encore le nettoyage des voiries. Cela pourrait faire décroître le prélèvement dans la nappe phréatique, ce qui n’est pas rien en période de sécheresse.

Parc des industries Artois-Flandres | 01.09.2025
L’eau, une ressource
à préserver : les raisons
d’un chantier essentiel
à préserver : les raisons
d’un chantier essentiel
Sur le Parc des Industries Artois-Flandres, le SIZIAF engage 550 000 € de travaux pour rénover son château d’eau et ainsi garantir la sécurité et la continuité de l’approvisionnement. En parallèle, la redevance évolue pour soutenir cet effort d’investissement.
VOIR PLUS

La Voix du Nord | 29.08.2025
Les écoles rafraîchies
pour la rentrée
pour la rentrée
Comme chaque été, les huit écoles de Harnes ont fait l’objet de rénovation. Ces travaux s’inscrivent dans un plan pluriannuel dont le dernier chapitre s’écrira l’été prochain.
VOIR PLUS
Les écoles de Harnes ont subi cette année encore une cure de rajeunissement et de modernisation. Cet été consacré aux travaux est le quatrième d’un plan de rénovation prévu pour durer 5 ans et qui concerne huit écoles de la commune.
L’école Émile-Zola. Elle a été le gros chantier de l’été, avec une enveloppe de 127 000 €, dont 59 000 € de subventions. Un portail sécurisé a été installé ainsi qu’une clôture dans le cadre du plan Vigipirate. La cour d’accueil a été entièrement repensée pour disposer d’un accès PMR faisant à la fois piste pour les vélos des enfants. Des plantations sont prévues à l’automne car une désimperméabilisation partielle du terrain a eu lieu. D’ailleurs, quatre écoles sur les huit auront une nouvelle végétalisation de leur cour. À l’arrière, un grand terrain herbeux aménagé permettra des cours à l’extérieur.

La cour de l’école Émile Zola a tété végétalisée.
L’école Pasteur-Curie. Les quatre classes de droite du bâtiment principal ont subi un rajeunissement. La charpente, la toiture, l’isolation et les plafonds ont été refaits ainsi que le revêtement de sol. L’éclairage LED intérieur a été remplacé et les murs ont été repeints. La facture pour la toiture du bâtiment s’élève à 500 000 € et s’étalera sur deux ans. Dans la cour, un ancien préfabriqué a été abattu laissant place à un nouvel espace qui sera engazonné.

Les peintures de l’école Pasteur-Curie ont été rafraîchies.
À l’arrière de l’école Pasteur-Curie, rue de Mirecourt, une entreprise crée cette semaine un parking de 30 places sur un sol végétalisé qui comprendra également une benne à verre enterrée de 5 m3.
L’école Anatole-France. En plus de travaux de peinture, le dortoir pour les tout-petits a été réaménagé avec des posters et une lumière tamisée à plusieurs tons.

Le dortoir de l’école Anatole France a été réaménagé.
L’école Louise-Michel. La cour ayant été refaite l’an dernier, c’était cette année au tour du sol recouvert intégralement d’un vinyle collé.

Un nouveau sol a été installé à l’école Louise-Michel.
Le relais petite enfance. En plus de la pose d’un ralentisseur dans la rue devant l’entrée du relais qui accueille 15 enfants à chaque séance, une nouvelle cour a été créée avec espaces verts et jeu sur sol souple.

Une nouvelle cour a été créée dans le relais petit enfance de la ville.
La Communauté d'Agglomération de Lens Liévin a participé à ce chantier de 55 000 €.
L’école Émile-Zola. Elle a été le gros chantier de l’été, avec une enveloppe de 127 000 €, dont 59 000 € de subventions. Un portail sécurisé a été installé ainsi qu’une clôture dans le cadre du plan Vigipirate. La cour d’accueil a été entièrement repensée pour disposer d’un accès PMR faisant à la fois piste pour les vélos des enfants. Des plantations sont prévues à l’automne car une désimperméabilisation partielle du terrain a eu lieu. D’ailleurs, quatre écoles sur les huit auront une nouvelle végétalisation de leur cour. À l’arrière, un grand terrain herbeux aménagé permettra des cours à l’extérieur.

La cour de l’école Émile Zola a tété végétalisée.
L’école Pasteur-Curie. Les quatre classes de droite du bâtiment principal ont subi un rajeunissement. La charpente, la toiture, l’isolation et les plafonds ont été refaits ainsi que le revêtement de sol. L’éclairage LED intérieur a été remplacé et les murs ont été repeints. La facture pour la toiture du bâtiment s’élève à 500 000 € et s’étalera sur deux ans. Dans la cour, un ancien préfabriqué a été abattu laissant place à un nouvel espace qui sera engazonné.

Les peintures de l’école Pasteur-Curie ont été rafraîchies.
À l’arrière de l’école Pasteur-Curie, rue de Mirecourt, une entreprise crée cette semaine un parking de 30 places sur un sol végétalisé qui comprendra également une benne à verre enterrée de 5 m3.
L’école Anatole-France. En plus de travaux de peinture, le dortoir pour les tout-petits a été réaménagé avec des posters et une lumière tamisée à plusieurs tons.

Le dortoir de l’école Anatole France a été réaménagé.
L’école Louise-Michel. La cour ayant été refaite l’an dernier, c’était cette année au tour du sol recouvert intégralement d’un vinyle collé.

Un nouveau sol a été installé à l’école Louise-Michel.
Le relais petite enfance. En plus de la pose d’un ralentisseur dans la rue devant l’entrée du relais qui accueille 15 enfants à chaque séance, une nouvelle cour a été créée avec espaces verts et jeu sur sol souple.

Une nouvelle cour a été créée dans le relais petit enfance de la ville.
La Communauté d'Agglomération de Lens Liévin a participé à ce chantier de 55 000 €.

Made in marseille | 28.08.2025
Jardins, buvette, piste cyclable, le parc Chanot a entamé sa transformation
Le nouveau gestionnaire du parc Chanot, GL Events, a présenté ses premiers aménagements du site pour le rendre plus accueillant au grand public. Jardins, pistes cyclables, buvette, esplanade de loisirs… À découvrir en images.
VOIR PLUS

Le Progrès | 26.08.2025
Des travaux de quatre mois
en cours rue des Salans
en cours rue des Salans
Dans le cadre de l’amélioration du réseau public d’eau potable, un important chantier de renforcement et de bouclage du réseau a débuté, vendredi 22 août dans la rue de Salans (RD 228).
VOIR PLUS
Ce projet s’inscrit dans une volonté de moderniser les infrastructures et de sécuriser l’alimentation en eau, notamment en remplaçant une conduite datant de 1950.

Les travaux ont débuté le 22 août, rue des Salans. Photo André Siclet
Ce qui est prévu
Dans le détail, les travaux comprennent le renouvellement de 750 mètres de conduite en fonte par une conduite neuve en fonte ductile DN 125, plus résistante et plus performante ; la reprise de 52 branchements d’eau potable, dont certains encore en plomb, pour garantir la conformité sanitaire et la fiabilité des raccordements ; le remplacement de sept vannes de sectionnement, indispensables pour l’entretien du réseau ; le remplacement d’un poteau incendie DN 100 devenu difficile à manœuvrer et l’installation d’un second poteau incendie ; le bouclage du réseau avec la conduite située rue des Chardonnerets, permettant d’améliorer la pression et la continuité de service.
La circulation perturbée
Côté circulation, le passage dans ces rues sera perturbé durant toute la durée du chantier, soit quatre mois. Des feux tricolores permettront de fluidifier le trafic alterné.
La maîtrise d’œuvre est assurée par Verdi Ingénierie Bourgogne-Franche-Comté, tandis que les travaux seront réalisés par l’ETA TP Clerc Véronique, implantée à Charnay (Doubs). Ce chantier s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration du réseau, au service de tous les habitants et usagers.

Les travaux ont débuté le 22 août, rue des Salans. Photo André Siclet
Ce qui est prévu
Dans le détail, les travaux comprennent le renouvellement de 750 mètres de conduite en fonte par une conduite neuve en fonte ductile DN 125, plus résistante et plus performante ; la reprise de 52 branchements d’eau potable, dont certains encore en plomb, pour garantir la conformité sanitaire et la fiabilité des raccordements ; le remplacement de sept vannes de sectionnement, indispensables pour l’entretien du réseau ; le remplacement d’un poteau incendie DN 100 devenu difficile à manœuvrer et l’installation d’un second poteau incendie ; le bouclage du réseau avec la conduite située rue des Chardonnerets, permettant d’améliorer la pression et la continuité de service.
La circulation perturbée
Côté circulation, le passage dans ces rues sera perturbé durant toute la durée du chantier, soit quatre mois. Des feux tricolores permettront de fluidifier le trafic alterné.
La maîtrise d’œuvre est assurée par Verdi Ingénierie Bourgogne-Franche-Comté, tandis que les travaux seront réalisés par l’ETA TP Clerc Véronique, implantée à Charnay (Doubs). Ce chantier s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration du réseau, au service de tous les habitants et usagers.


 Designer de territoires
Designer de territoires Suivez-nous sur Linkedin
Suivez-nous sur Linkedin