
mesinfos.fr, Le Journal du Bâtiment et des TP | 12.08.2025
Construire contre la chaleur : comment la végétation peut faire la différence en région lyonnaise
Dans la métropole de Lyon, la chaleur grimpe et les canicules s’intensifient. La végétation apparaît comme une solution clé contre les îlots de chaleur urbains. Encore faut-il pouvoir planter, partout, et dans les bonnes conditions.
VOIR PLUS
Le cap des +1,5 °C de réchauffement global est désormais hors de portée et à l'échelle locale, les effets se font déjà sentir. À Lyon, la température moyenne a même augmenté de 2,4 °C depuis 1960.
Face à cette hausse, la Ville explore plusieurs pistes pour rendre la chaleur plus supportable : désimperméabilisation des sols, isolation des bâtiments, réduction des émissions de chaleur liées aux activités humaines…
Mais parmi toutes ces solutions, une approche se détache particulièrement : celle du végétal. Refroidir la ville par la nature s'impose aujourd'hui comme l'un des leviers les plus efficaces pour lutter contre les îlots de chaleur urbains.
La végétation serait le moyen le plus efficace de refroidir les villes
D'abord, les arbres apportent de l'ombre, grâce à leurs feuillages. Ensuite, les plantes et le sol participent au phénomène d'évapotranspiration, qui consiste à libérer de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, contribuant à abaisser la température ressentie. Enfin, la végétation diminue de manière générale le rayonnement solaire au sol, puisque la plantation d'arbres nécessite d'avoir peu ou pas de bitume.
Une étude de l'Insee, menée sur neuf grandes villes françaises (dont Lyon) montre l'effet particulièrement efficace de la végétation contre la chaleur par rapport à d'autres facteurs. Dans le cas de Lyon, la végétation permet de faire baisser l'index de chaleur urbain de 1,14 degré.
C'est de loin le facteur qui a le plus fort impact positif sur la chaleur urbaine, quelle que soit la ville étudiée.

©Famke Panissières, a partir des données Insee - Variation de l’index d’îlot de chaleur urbain (en °C) en fonction de différents facteurs.
A l'ouest de Lyon, moins d'îlots de chaleur grâce à la végétation
D'autres données présentent une corrélation claire entre chaleur et végétation. La carte ci-dessous montre l'importance de l'effet d'îlot de chaleur urbain dans la Métropole. L'ouest lyonnais, avec les Monts d'Or, souffre le moins du phénomène. À l'inverse, le centre-ville de Lyon subit le plus la chaleur.

© Famke Panissières, QGIS - A partir de Data Grand Lyon - Exposition aux ilots de chaleur urbains (ICU) dans la Métropole de Lyon.
Une différence qui s'explique facilement : l'ouest lyonnais est nettement plus végétalisé, comme le montre la carte ci-dessous. À l'inverse, le centre est beaucoup moins pourvu en espaces verts, dispose de peu de cours d'eau et se caractérise par un bâti dense et très minéralisé.

© Famke Panissières, QGIS - A partir de Data Grand Lyon, BD Topo et BD Topage – Végétation et réseau hydrographique du Grand Lyon.
La forêt urbaine de la Part-Dieu, un exemple à suivre ?
Partant de ce constat, les institutions publiques misent sur la végétalisation de l'espace public, notamment dans les quartiers les plus minéralisés du centre-ville. C'est le cas de la Part-Dieu, particulièrement exposé lors des épisodes de canicule. Pour contrer la chaleur, la Société publique locale (SPL) de la Part-Dieu, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont initié un projet de forêt urbaine, qui devrait être achevé d'ici à 2030.
Le but : ajouter 9 600 mètres carrés de canopée, planter 1 400 arbres supplémentaires et doubler les surfaces perméables. Il est estimé que ce projet permettrait un gain thermique de cinq à sept degrés en fonction des zones.

© Famke Panissières - La place des Martyrs, anciennement un parking, a été totalement réaménagée en un "véritable jardin" d'après le maire de Lyon, Grégory Doucet.
Des tentatives d'adaptation encore limitées : le cas de la Presqu'île
Du côté de la Presqu'île, autre quartier où l'effet d'îlot de chaleur urbain est particulièrement important, c'est une autre paire de manches : ce quartier dense, avec un bâti ancien et élevé, est par zones difficilement végétalisable.
Un projet de plantation d'arbres sur la place Bellecour avait d'ailleurs été envisagé en 2022 dans le du premier budget participatif de la Ville. Mais il a finalement été abandonné à cause de la présence du métro et de parkings souterrains qui empêcheraient le développement racinaire, en plus du caractère patrimonial de la place Bellecour qui complique tout aménagement.
A la place, depuis juillet, une installation temporaire nommée Tissage urbain a été construite. Elle doit y rester jusqu'en 2029, avec l'objectif d'apporter un peu d'ombre sur une vaste zone très minérale et exposée en plein soleil.

© Famke Panissières - Tissage urbain a fini d'être installé début juillet sur la place Bellecour.
Mais l'œuvre est considérée par beaucoup comme inefficace contre la chaleur, étant trop ajourée pour offrir une véritable surface ombragée. Un problème alors que le quartier devient un véritable four lors des fortes chaleurs : on pouvait y enregistrer jusqu'à quatre degrés de différence avec des zones plus périphériques lors des dernières canicules.
D'autres solutions au-delà des pôles de verdure
Les spécialistes explorent ainsi d'autres pistes que la simple création d'îlots végétalisés. Dans un article publié en 2024, Éric Larrey, directeur de l'innovation chez Verdi ingénierie, propose d'améliorer les “ chemins de confort ”, c'est-à-dire “ des itinéraires ombragés permettant de rejoindre les îlots de fraîcheur sans traverser de longues zones exposées, parfois inaccessibles aux personnes fragiles ”.

© Eric Larrey, Construction21, 6 mai 2024 - Connexion des îlots de verdure (parcs, jardins...) en fonction du niveau de confort des rues actuellement dans le Grand Lyon.
Il défend aussi le principe des “ 3-30-300 ”, imaginé par le chercheur néerlandais Cecil Konijnendijk : voir au moins trois arbres depuis chez soi, atteindre 30 % de canopée dans chaque quartier et vivre à moins de 300 mètres d'un parc. Une norme qui pourrait avoir des effets particulièrement bénéfiques sur la santé physique et mentale des habitants.
En tout cas, dans le Grand Lyon, les projets se multiplient : reste à voir s'ils suffiront à rafraîchir durablement la ville.
Face à cette hausse, la Ville explore plusieurs pistes pour rendre la chaleur plus supportable : désimperméabilisation des sols, isolation des bâtiments, réduction des émissions de chaleur liées aux activités humaines…
Mais parmi toutes ces solutions, une approche se détache particulièrement : celle du végétal. Refroidir la ville par la nature s'impose aujourd'hui comme l'un des leviers les plus efficaces pour lutter contre les îlots de chaleur urbains.
| Qu'est-ce qu'un îlot de chaleur urbain ?
Selon Météo France, "le phénomène d'îlot de chaleur urbain (ICU) se manifeste par des températures plus élevées en milieu urbain que dans les zones rurales environnantes, surtout la nuit et pendant les épisodes de canicule".
Certains facteurs peuvent en effet empêcher les villes de se refroidir comme le modèle d'urbanisation, les revêtements des sols ou encore le manque de végétalisation ou d'eau. |
La végétation serait le moyen le plus efficace de refroidir les villes
D'abord, les arbres apportent de l'ombre, grâce à leurs feuillages. Ensuite, les plantes et le sol participent au phénomène d'évapotranspiration, qui consiste à libérer de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, contribuant à abaisser la température ressentie. Enfin, la végétation diminue de manière générale le rayonnement solaire au sol, puisque la plantation d'arbres nécessite d'avoir peu ou pas de bitume.
Une étude de l'Insee, menée sur neuf grandes villes françaises (dont Lyon) montre l'effet particulièrement efficace de la végétation contre la chaleur par rapport à d'autres facteurs. Dans le cas de Lyon, la végétation permet de faire baisser l'index de chaleur urbain de 1,14 degré.
C'est de loin le facteur qui a le plus fort impact positif sur la chaleur urbaine, quelle que soit la ville étudiée.

©Famke Panissières, a partir des données Insee - Variation de l’index d’îlot de chaleur urbain (en °C) en fonction de différents facteurs.
A l'ouest de Lyon, moins d'îlots de chaleur grâce à la végétation
D'autres données présentent une corrélation claire entre chaleur et végétation. La carte ci-dessous montre l'importance de l'effet d'îlot de chaleur urbain dans la Métropole. L'ouest lyonnais, avec les Monts d'Or, souffre le moins du phénomène. À l'inverse, le centre-ville de Lyon subit le plus la chaleur.

© Famke Panissières, QGIS - A partir de Data Grand Lyon - Exposition aux ilots de chaleur urbains (ICU) dans la Métropole de Lyon.
Une différence qui s'explique facilement : l'ouest lyonnais est nettement plus végétalisé, comme le montre la carte ci-dessous. À l'inverse, le centre est beaucoup moins pourvu en espaces verts, dispose de peu de cours d'eau et se caractérise par un bâti dense et très minéralisé.

© Famke Panissières, QGIS - A partir de Data Grand Lyon, BD Topo et BD Topage – Végétation et réseau hydrographique du Grand Lyon.
La forêt urbaine de la Part-Dieu, un exemple à suivre ?
Partant de ce constat, les institutions publiques misent sur la végétalisation de l'espace public, notamment dans les quartiers les plus minéralisés du centre-ville. C'est le cas de la Part-Dieu, particulièrement exposé lors des épisodes de canicule. Pour contrer la chaleur, la Société publique locale (SPL) de la Part-Dieu, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont initié un projet de forêt urbaine, qui devrait être achevé d'ici à 2030.
Le but : ajouter 9 600 mètres carrés de canopée, planter 1 400 arbres supplémentaires et doubler les surfaces perméables. Il est estimé que ce projet permettrait un gain thermique de cinq à sept degrés en fonction des zones.

© Famke Panissières - La place des Martyrs, anciennement un parking, a été totalement réaménagée en un "véritable jardin" d'après le maire de Lyon, Grégory Doucet.
Des tentatives d'adaptation encore limitées : le cas de la Presqu'île
Du côté de la Presqu'île, autre quartier où l'effet d'îlot de chaleur urbain est particulièrement important, c'est une autre paire de manches : ce quartier dense, avec un bâti ancien et élevé, est par zones difficilement végétalisable.
Un projet de plantation d'arbres sur la place Bellecour avait d'ailleurs été envisagé en 2022 dans le du premier budget participatif de la Ville. Mais il a finalement été abandonné à cause de la présence du métro et de parkings souterrains qui empêcheraient le développement racinaire, en plus du caractère patrimonial de la place Bellecour qui complique tout aménagement.
A la place, depuis juillet, une installation temporaire nommée Tissage urbain a été construite. Elle doit y rester jusqu'en 2029, avec l'objectif d'apporter un peu d'ombre sur une vaste zone très minérale et exposée en plein soleil.

© Famke Panissières - Tissage urbain a fini d'être installé début juillet sur la place Bellecour.
Mais l'œuvre est considérée par beaucoup comme inefficace contre la chaleur, étant trop ajourée pour offrir une véritable surface ombragée. Un problème alors que le quartier devient un véritable four lors des fortes chaleurs : on pouvait y enregistrer jusqu'à quatre degrés de différence avec des zones plus périphériques lors des dernières canicules.
D'autres solutions au-delà des pôles de verdure
Les spécialistes explorent ainsi d'autres pistes que la simple création d'îlots végétalisés. Dans un article publié en 2024, Éric Larrey, directeur de l'innovation chez Verdi ingénierie, propose d'améliorer les “ chemins de confort ”, c'est-à-dire “ des itinéraires ombragés permettant de rejoindre les îlots de fraîcheur sans traverser de longues zones exposées, parfois inaccessibles aux personnes fragiles ”.

© Eric Larrey, Construction21, 6 mai 2024 - Connexion des îlots de verdure (parcs, jardins...) en fonction du niveau de confort des rues actuellement dans le Grand Lyon.
Il défend aussi le principe des “ 3-30-300 ”, imaginé par le chercheur néerlandais Cecil Konijnendijk : voir au moins trois arbres depuis chez soi, atteindre 30 % de canopée dans chaque quartier et vivre à moins de 300 mètres d'un parc. Une norme qui pourrait avoir des effets particulièrement bénéfiques sur la santé physique et mentale des habitants.
En tout cas, dans le Grand Lyon, les projets se multiplient : reste à voir s'ils suffiront à rafraîchir durablement la ville.
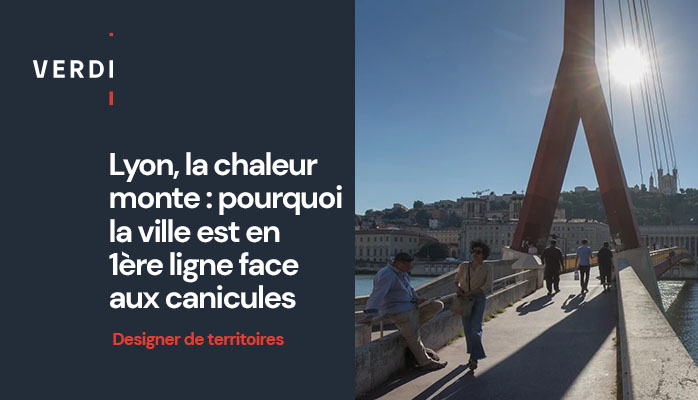
mesinfos.fr, Le Journal du Bâtiment et des TP | 11.08.2025
Lyon, la chaleur monte : pourquoi la ville est en première ligne face aux canicules
Lyon ne se contente pas de suivre la tendance du réchauffement climatique : topographie, urbanisation et manque de végétation en font une ville particulièrement vulnérable face aux vagues de chaleur. Explications.
VOIR PLUS
Chaque été, Lyon étouffe un peu plus. Le 19 juin dernier, une première vague de chaleur s’est abattue sur la métropole. Avec des températures avoisinant les 40 °C en plein centre-ville, elle a duré plus de deux semaines. Un record absolu en France depuis 1976.
Si ces épisodes caniculaires ne sont pas propres à Lyon, la capitale des Gaules se distingue par son exposition particulièrement marquée à cette chaleur extrême et ce pour plusieurs raisons.
Chaleur à Lyon : des spécificités climatiques
Selon la classification du climat de Köppen, Lyon possède un climat semi-continental avec des influences méditerranéennes. Ainsi, la ville connaît normalement des étés souvent très chauds et secs, des hivers parfois froids et des variations de température marquées tout au long de l’année. Cette situation est due à sa position géographique, au carrefour de plusieurs influences climatiques : l’air océanique qui arrive de l’ouest, l’air continental venu de l’est et les remontées chaudes du sud en provenance de la Méditerranée.
La ville est aussi peu exposée aux vents frais venant de l’Atlantique : le vent dominant est souvent un vent du sud, sec et chaud, qui accentue la sensation de chaleur en été. De plus, le manque de brassage d’air empêche la dissipation rapide de la chaleur.
Lyon est aussi située dans une sorte de cuvette naturelle, entourée de collines comme Fourvière ou la Croix-Rousse : ce relief piège l’air chaud et limite la circulation de l’air, ce qui contribue à faire grimper les températures.
Des épisodes caniculaires renforcés par les effets d’îlot de chaleur urbain
Mais cette configuration géographique ne suffit pas à elle seule à expliquer la surchauffe urbaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. L’urbanisation joue un rôle central : le béton, l’asphalte et l’absence de végétation emmagasinent la chaleur durant la journée et la restituent la nuit, empêchant les quartiers denses de se rafraîchir. Ce phénomène, bien connu, est appelé îlot de chaleur urbain (ICU), comme représenté ci-dessous.

© Famke Panissières pour le Journal du BTP – Explication schématique de l’ilot de chaleur urbain (ICU). Les températures peuvent différer de plus de cinq degrés entre le centre-ville et les périphéries à cause de l'effet d'îlot de chaleur urbain.
À Lyon, les ICU prennent deux formes principales, comme l’explique Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole de Lyon délégué au climat, à l'énergie et aux réseaux de chaleur :
“ D’abord le centre, très minéral et peu végétalisé, comme le nord de la Presqu’île ou la rive gauche entre le Rhône et la Part-Dieu, sont particulièrement concernés. Puis dans l’est lyonnais, avec des secteurs cumulant une forte densité de bâti, des zones d’activité industrielle et des espaces agricoles moissonnés dès l’été, qui laissent derrière eux des sols arides. ”
Cette répartition est matérialisée sur la carte ci-dessous :

© Famke Panissières, QGIS - A partir de Data Grand Lyon - Exposition aux ilots de chaleur urbains (ICU) dans la Métropole de Lyon. Lyon figure d'ailleurs parmi les dix communes françaises les plus exposées aux îlots de chaleur urbains d'après Météo France, avec des écarts de température pouvant atteindre 4,5 °C entre les quartiers centraux et les zones plus fraîches.
Selon Éric Larrey, directeur de l’innovation chez Verdi ingénierie, groupe lyonnais dédié à l'aménagement du territoire et à la construction, la situation de l’agglomération lyonnaise est particulièrement préoccupante : “ Si 16 % de la population [française] est soumise aux ICU sévères et 34 % dispose de moins de 30 % d’espaces végétalisés de proximité, ces proportions passent à 30 % et 61 % pour Lyon, suivie de Villeurbanne à 15 % et 45 %. ”
Un futur préoccupant face au réchauffement climatique
Face au réchauffement climatique, ces effets ne vont que s’amplifier. Le Rhône fait partie des départements qui se réchauffent le plus rapidement en France, avec la remontée progressive du climat méditerranéen le long de la vallée du Rhône.
Depuis 2004, c’est le département qui a connu le plus de journées en vigilance canicule, avec un total de 174 jours d’alerte, dont quatre en vigilance rouge, selon un décompte du Monde. La canicule de juin 2025, particulièrement longue et intense, en est un nouvel exemple.
Pour Lyon, les projections pour les décennies à venir sont alarmantes : entre 1976 et 2005, la ville enregistrait en moyenne 60 jours à plus de 25 °C par an. D'ici à 2050, les estimations varient selon trois scénarios climatiques. D'après le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), cette moyenne pourrait grimper entre 73 et 91 jours.

Comparaison du nombre moyen de jours > 25 °C : 1976–2005 et projections 2050 du GIEC
Les écarts de température entre le centre-ville et les zones rurales pourraient atteindre dix degrés, rendant certains secteurs quasiment invivables l’été.
"Adapter" : le maître mot de la lutte contre les chaleurs extrêmes à Lyon
Face à cette situation, l’adaptation devient incontournable. "Il faut une rénovation énergétique massive, notamment des passoires thermiques et en priorité dans le logement social", souligne Philippe Guelpa-Bonaro.
Les institutions misent aussi fortement sur la végétalisation, considérée comme l’un des moyens les plus efficaces en ville. D’autres leviers sont explorés, comme remplacer les revêtements sombres par des matériaux plus clairs, désimperméabiliser les sols pour favoriser l’infiltration de l’eau, ou encore adapter l’urbanisme pour laisser circuler l’air.

© Famke Panissières - Les institutions lyonnaises entreprennent divers aménagements pour limiter la chaleur en ville, comme en végétalisant davantage la rive gauche des quais du Rhône.
Le chantier est immense, et le temps presse. Éric Larrey souligne l’importance de ces aménagements, tout en appelant à une prise de conscience plus large : “ On ne pourra pas continuer à marcher en pleine rue entre midi et deux comme si de rien n’était. L’aménagement urbain est essentiel, mais il a ses limites. À un moment, il faudra accepter de changer nos habitudes de vie, peut-être même renoncer à certaines. ”
L’ingénieur évoque par exemple un changement des rythmes de vie, à l’image de l’Espagne, où l’on évite de sortir aux heures les plus chaudes. Une chose est sûre : pour affronter la chaleur, il faudra repenser la ville, dans sa forme comme dans les habitudes qu’elle impose.
Si ces épisodes caniculaires ne sont pas propres à Lyon, la capitale des Gaules se distingue par son exposition particulièrement marquée à cette chaleur extrême et ce pour plusieurs raisons.
Chaleur à Lyon : des spécificités climatiques
Selon la classification du climat de Köppen, Lyon possède un climat semi-continental avec des influences méditerranéennes. Ainsi, la ville connaît normalement des étés souvent très chauds et secs, des hivers parfois froids et des variations de température marquées tout au long de l’année. Cette situation est due à sa position géographique, au carrefour de plusieurs influences climatiques : l’air océanique qui arrive de l’ouest, l’air continental venu de l’est et les remontées chaudes du sud en provenance de la Méditerranée.
La ville est aussi peu exposée aux vents frais venant de l’Atlantique : le vent dominant est souvent un vent du sud, sec et chaud, qui accentue la sensation de chaleur en été. De plus, le manque de brassage d’air empêche la dissipation rapide de la chaleur.
Lyon est aussi située dans une sorte de cuvette naturelle, entourée de collines comme Fourvière ou la Croix-Rousse : ce relief piège l’air chaud et limite la circulation de l’air, ce qui contribue à faire grimper les températures.
Des épisodes caniculaires renforcés par les effets d’îlot de chaleur urbain
Mais cette configuration géographique ne suffit pas à elle seule à expliquer la surchauffe urbaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. L’urbanisation joue un rôle central : le béton, l’asphalte et l’absence de végétation emmagasinent la chaleur durant la journée et la restituent la nuit, empêchant les quartiers denses de se rafraîchir. Ce phénomène, bien connu, est appelé îlot de chaleur urbain (ICU), comme représenté ci-dessous.

© Famke Panissières pour le Journal du BTP – Explication schématique de l’ilot de chaleur urbain (ICU). Les températures peuvent différer de plus de cinq degrés entre le centre-ville et les périphéries à cause de l'effet d'îlot de chaleur urbain.
À Lyon, les ICU prennent deux formes principales, comme l’explique Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole de Lyon délégué au climat, à l'énergie et aux réseaux de chaleur :
“ D’abord le centre, très minéral et peu végétalisé, comme le nord de la Presqu’île ou la rive gauche entre le Rhône et la Part-Dieu, sont particulièrement concernés. Puis dans l’est lyonnais, avec des secteurs cumulant une forte densité de bâti, des zones d’activité industrielle et des espaces agricoles moissonnés dès l’été, qui laissent derrière eux des sols arides. ”
Cette répartition est matérialisée sur la carte ci-dessous :

© Famke Panissières, QGIS - A partir de Data Grand Lyon - Exposition aux ilots de chaleur urbains (ICU) dans la Métropole de Lyon. Lyon figure d'ailleurs parmi les dix communes françaises les plus exposées aux îlots de chaleur urbains d'après Météo France, avec des écarts de température pouvant atteindre 4,5 °C entre les quartiers centraux et les zones plus fraîches.
Selon Éric Larrey, directeur de l’innovation chez Verdi ingénierie, groupe lyonnais dédié à l'aménagement du territoire et à la construction, la situation de l’agglomération lyonnaise est particulièrement préoccupante : “ Si 16 % de la population [française] est soumise aux ICU sévères et 34 % dispose de moins de 30 % d’espaces végétalisés de proximité, ces proportions passent à 30 % et 61 % pour Lyon, suivie de Villeurbanne à 15 % et 45 %. ”
Un futur préoccupant face au réchauffement climatique
Face au réchauffement climatique, ces effets ne vont que s’amplifier. Le Rhône fait partie des départements qui se réchauffent le plus rapidement en France, avec la remontée progressive du climat méditerranéen le long de la vallée du Rhône.
Depuis 2004, c’est le département qui a connu le plus de journées en vigilance canicule, avec un total de 174 jours d’alerte, dont quatre en vigilance rouge, selon un décompte du Monde. La canicule de juin 2025, particulièrement longue et intense, en est un nouvel exemple.
Pour Lyon, les projections pour les décennies à venir sont alarmantes : entre 1976 et 2005, la ville enregistrait en moyenne 60 jours à plus de 25 °C par an. D'ici à 2050, les estimations varient selon trois scénarios climatiques. D'après le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), cette moyenne pourrait grimper entre 73 et 91 jours.

Comparaison du nombre moyen de jours > 25 °C : 1976–2005 et projections 2050 du GIEC
Les écarts de température entre le centre-ville et les zones rurales pourraient atteindre dix degrés, rendant certains secteurs quasiment invivables l’été.
"Adapter" : le maître mot de la lutte contre les chaleurs extrêmes à Lyon
Face à cette situation, l’adaptation devient incontournable. "Il faut une rénovation énergétique massive, notamment des passoires thermiques et en priorité dans le logement social", souligne Philippe Guelpa-Bonaro.
Les institutions misent aussi fortement sur la végétalisation, considérée comme l’un des moyens les plus efficaces en ville. D’autres leviers sont explorés, comme remplacer les revêtements sombres par des matériaux plus clairs, désimperméabiliser les sols pour favoriser l’infiltration de l’eau, ou encore adapter l’urbanisme pour laisser circuler l’air.

© Famke Panissières - Les institutions lyonnaises entreprennent divers aménagements pour limiter la chaleur en ville, comme en végétalisant davantage la rive gauche des quais du Rhône.
Le chantier est immense, et le temps presse. Éric Larrey souligne l’importance de ces aménagements, tout en appelant à une prise de conscience plus large : “ On ne pourra pas continuer à marcher en pleine rue entre midi et deux comme si de rien n’était. L’aménagement urbain est essentiel, mais il a ses limites. À un moment, il faudra accepter de changer nos habitudes de vie, peut-être même renoncer à certaines. ”
L’ingénieur évoque par exemple un changement des rythmes de vie, à l’image de l’Espagne, où l’on évite de sortir aux heures les plus chaudes. Une chose est sûre : pour affronter la chaleur, il faudra repenser la ville, dans sa forme comme dans les habitudes qu’elle impose.

Le Bien Public | 10.08.2025
Pour faciliter l’accès à la rocade sud depuis le pôle de santé, un shunt va être créé
Une voie va être créée depuis le pôle à dominante santé des Longènes - en construction - pour rejoindre la bretelle d'insertion de la rocade, en direction du sud. Cet aménagement (un shunt) permettra aux usagers d'éviter l'échangeur n°42, saturé aux heures de pointe.
VOIR PLUS
La construction de Symbiose les Longènes a commencé il y a quelques mois. Mais lorsque tous les bâtiments de ce nouveau pôle tertiaire à dominante santé seront livrés dans quelques années, le trafic routier sera encore plus important ... dans une zone déjà bien congestionnée.
Comme cela avait été envisagé au printemps 2023 pour fluidifier la circulation dans le secteur du CHU Dijon-Bourgogne, un shunt va être créé.

Le shunt permettra aux usagers du pôle Les Longènes (à gauche) de rejoindre la bretelle d’insertion de la rocade (à droite) sans emprunter l’échangeur n° 62. Photo Rémy Dissoubray
Autrement dit, une voie qui permettra aux usagers de rejoindre la bretelle d'insertion de la rocade, en direction du sud de Dijon, en tournant à droite juste avant l'échangeur n° 42. Elle démarrera au niveau de la future sortie de la zone d'activités, faisant ainsi passer la rue Jean-Moulin à trois voies de circulation au lieu de deux actuellement.

Le shunt routier sera réalisé le long de la rue Jean-Moulin. Il permettra aux usagers souhaitant prendre la rocade en direction du sud d’accéder à la bretelle d’insertion sans avoir à emprunter l’échangeur n° 62. Photo Rémy Dissoubray
Un marché public lancé pour cette opération
Quatre autres solutions avaient été envisagées lors des études de faisabilité menées en 2022 par Verdi Ingénierie Sud-Ouest. Le projet ayant été entériné, Dijon Métropole cherche désormais la société qui pourra réaliser ce shunt (la maîtrise d'œuvre a été confiée à Verdi). Les candidats ont jusqu'au 15 septembre à midi pour se positionner sur ce marché public ouvert le 4 août. Le calendrier prévisionnel de l'opération et son montant ne sont pas encore connus. Lors d'une réunion publique organisée en 2023, le coût d'1,3 M€ avait été évoqué.

Le premier bâtiment du pôle à dominante santé à sortir de terre est la résidence étudiante de 170 logements qui seront prioritairement destinés aux étudiants en santé, du groupe Les Belles Années. Photo Rémy Dissoubray
Le pôle Symbiose les Longènes développé par Eiffage Aménagement s'étendra sur une superficie de 39 000 m², et comprendra une résidence destinée aux étudiants en médecine, un centre de dialyse, un campus paramédical, des bureaux et des commerces.
Comme cela avait été envisagé au printemps 2023 pour fluidifier la circulation dans le secteur du CHU Dijon-Bourgogne, un shunt va être créé.

Le shunt permettra aux usagers du pôle Les Longènes (à gauche) de rejoindre la bretelle d’insertion de la rocade (à droite) sans emprunter l’échangeur n° 62. Photo Rémy Dissoubray
Autrement dit, une voie qui permettra aux usagers de rejoindre la bretelle d'insertion de la rocade, en direction du sud de Dijon, en tournant à droite juste avant l'échangeur n° 42. Elle démarrera au niveau de la future sortie de la zone d'activités, faisant ainsi passer la rue Jean-Moulin à trois voies de circulation au lieu de deux actuellement.

Le shunt routier sera réalisé le long de la rue Jean-Moulin. Il permettra aux usagers souhaitant prendre la rocade en direction du sud d’accéder à la bretelle d’insertion sans avoir à emprunter l’échangeur n° 62. Photo Rémy Dissoubray
Un marché public lancé pour cette opération
Quatre autres solutions avaient été envisagées lors des études de faisabilité menées en 2022 par Verdi Ingénierie Sud-Ouest. Le projet ayant été entériné, Dijon Métropole cherche désormais la société qui pourra réaliser ce shunt (la maîtrise d'œuvre a été confiée à Verdi). Les candidats ont jusqu'au 15 septembre à midi pour se positionner sur ce marché public ouvert le 4 août. Le calendrier prévisionnel de l'opération et son montant ne sont pas encore connus. Lors d'une réunion publique organisée en 2023, le coût d'1,3 M€ avait été évoqué.

Le premier bâtiment du pôle à dominante santé à sortir de terre est la résidence étudiante de 170 logements qui seront prioritairement destinés aux étudiants en santé, du groupe Les Belles Années. Photo Rémy Dissoubray
Le pôle Symbiose les Longènes développé par Eiffage Aménagement s'étendra sur une superficie de 39 000 m², et comprendra une résidence destinée aux étudiants en médecine, un centre de dialyse, un campus paramédical, des bureaux et des commerces.
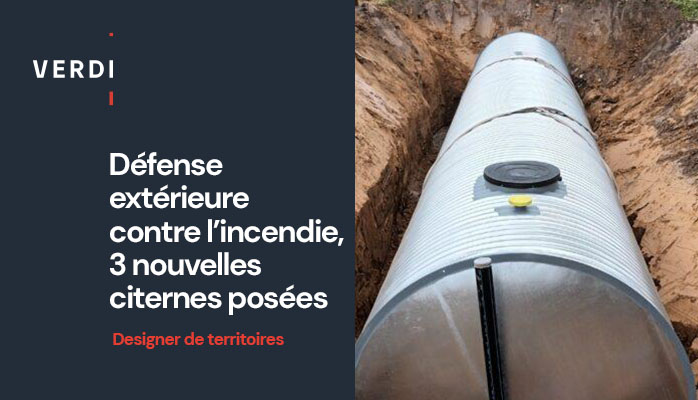
L’Abeille de la Ternoise | 07.08.2025
Défense extérieure contre l’incendie, 3 nouvelles citernes posées
Il y a vingt-quatre mois, la municipalité a suivi les conseils du SDIS pour la défense incendie sur la commune d’Acheux-en-Amiénois. C’est à la société Verdi Picardie qu’a été confiée l’étude du projet.
VOIR PLUS
L’étude ayant été effectuée, la commune a confié à la société la maîtrise d’œuvre en 2023. En 2024, le compte rendu a été déposé aux élus et au SDIS. Il y a eu des réajustements ainsi que des calculs en besoin en eau. La validation a eu lieu cette même année.
La commune disposait de deux citernes à incendies, une au collège et une à l’Ehpad. Après contrôle des citernes et du bassin existant, il y a eu la vidange et le curage, l’inspection et le diagnostic des parois des cuves. L’étanchéité a été reprise. Des dispositifs d’aspiration de type poteau (type H) plaques indicatrices de PEI et de vannes, ainsi que la signalisation de l’aire d’aspiration, ont été appliqués.
Où sont les citernes ?
La pose de trois citernes a été faite, une rue de Léalvillers de 60 m³, une rue de Varennes de 120 m³ et une au coin de la place de ballon au poing de 120 m³. Celle au terrain de ballon au poing couvrira le centre du village, celle rue de Léalvillers couvrira la salle des fêtes qui est un établissement public et la rue. Celle rue de Varennes couvrira le périmètre de sortie du village.
Il existera toujours la mutualisation du point d’eau à la déchetterie avec la communauté de communes du Pays du Coquelicot. La commune y a installé une canne d’aspiration et un portail spécial d’accès pour les pompiers. Le bassin situé à Intermarché rue de Léalvillers a été mis en conformité. Tous les poteaux incendie ont été remplacés à neuf.
La citerne située sur le terrain de ballon au poing a été étudiée et enterrée profondément, afin de laisser le passage aux poids lourds, comme les camions de forains qui s’installent sur la place. Celle de la salle des fêtes n’a pas été enterrée aussi profondément, car il va y avoir un parking pour voitures début octobre. C’est l’établissement Bouffel qui a décroché cette installation.
La municipalité remercie le SDIS qui les a aidés dans chaque étape de ce lourd projet, du début à la validation. Ces travaux avaient été votés à l’unanimité par le conseil municipal. À savoir : un coût total 360 000 € HT (hors taxe). La dotation de la DETR est de 108 000 € soit 30 % du financement. Le reste à charge pour la commune est de 252 000 € HT.
La commune disposait de deux citernes à incendies, une au collège et une à l’Ehpad. Après contrôle des citernes et du bassin existant, il y a eu la vidange et le curage, l’inspection et le diagnostic des parois des cuves. L’étanchéité a été reprise. Des dispositifs d’aspiration de type poteau (type H) plaques indicatrices de PEI et de vannes, ainsi que la signalisation de l’aire d’aspiration, ont été appliqués.
Où sont les citernes ?
La pose de trois citernes a été faite, une rue de Léalvillers de 60 m³, une rue de Varennes de 120 m³ et une au coin de la place de ballon au poing de 120 m³. Celle au terrain de ballon au poing couvrira le centre du village, celle rue de Léalvillers couvrira la salle des fêtes qui est un établissement public et la rue. Celle rue de Varennes couvrira le périmètre de sortie du village.
Il existera toujours la mutualisation du point d’eau à la déchetterie avec la communauté de communes du Pays du Coquelicot. La commune y a installé une canne d’aspiration et un portail spécial d’accès pour les pompiers. Le bassin situé à Intermarché rue de Léalvillers a été mis en conformité. Tous les poteaux incendie ont été remplacés à neuf.
La citerne située sur le terrain de ballon au poing a été étudiée et enterrée profondément, afin de laisser le passage aux poids lourds, comme les camions de forains qui s’installent sur la place. Celle de la salle des fêtes n’a pas été enterrée aussi profondément, car il va y avoir un parking pour voitures début octobre. C’est l’établissement Bouffel qui a décroché cette installation.
La municipalité remercie le SDIS qui les a aidés dans chaque étape de ce lourd projet, du début à la validation. Ces travaux avaient été votés à l’unanimité par le conseil municipal. À savoir : un coût total 360 000 € HT (hors taxe). La dotation de la DETR est de 108 000 € soit 30 % du financement. Le reste à charge pour la commune est de 252 000 € HT.
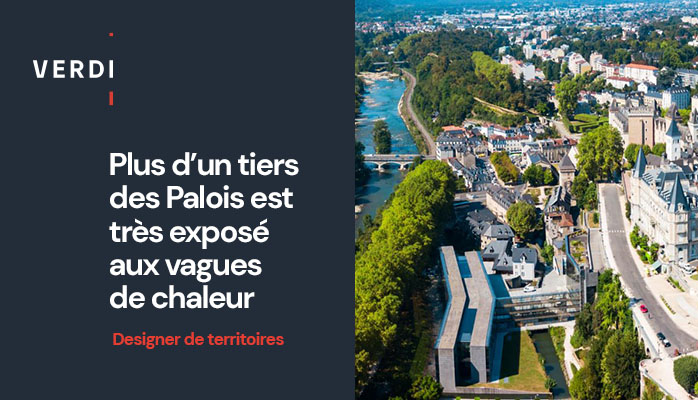
La République des Pyrénées | 07.08.2025
Canicule et îlots de chaleur : plus d'un tiers des Palois est très exposé aux vagues de chaleur
Alors que, ce jeudi 7 août, la cité royale entre dans une nouvelle vague de canicule, une étude met en évidence les zones de la ville les plus incommodées par les périodes de forte chaleur.
VOIR PLUS

La carte réalisée par Verdi détaille le degré d’exposition des quartiers palois aux îlots de chaleur urbains (ICU). La note 1 représente une exposition faible (vert) et 5 une exposition forte (rouge). Cette échelle résulte du croisement entre la vulnérabilité du bâtiment aux ICU et le taux de végétation présent dans un rayon de 300 m autour du bâtiment. ©Verdi ingénierie
Tous les quartiers palois ne supportent pas les vagues de canicule de la même manière. Tandis que l’hypercentre surchauffe, les couronnes périphériques respirent un peu mieux lors de ces périodes de chaleur. Un constat que mettent en évidence les données en accès libre de l’agglomération ainsi qu’une étude menée par le Groupe Verdi ingénierie en 2024.
Sans surprise, c’est donc le cœur de la cité royale qui se révèle le plus « vulnérable » aux îlots de chaleur urbains (ICU), ces zones qui en raison de la concentration des habitations et du manque de végétalisation conservent (ou émettent) le plus la chaleur. Les voyants s’allument ainsi en rouge à l’intérieur du périmètre, constitué au Nord par le boulevard Alsace-Lorraine, au Sud par la rue Henri-Faisans et le boulevard des Pyrénées et à l’Ouest par la caserne Bernadotte. Le Nord du quartier du 14-Juillet est également concerné. Et les pics de chaleur sont atteints au niveau des zones commerciales (Leclerc, Auchan, Quartier libre…), comme le relèvent les datas de l’agglo.
27 000 Palois concernés
Ces zones rouges « possèdent un faible taux de végétation de proximité. Elles apparaissent donc comme très exposées », indique l’étude réalisée. « Selon un schéma assez classique, le centre-ville est assez dense en population », constate Clara Gerstein, chargée d’étude aménagement urbain et îlots de chaleur au sein du Groupe Verdi ingénierie. À l’inverse, des « îlots de fraîcheur » naturels se situent le long du Gave de Pau et au nord de la ville, qui profite de la forêt de Bastard.
La localisation de ces ICU permet de mettre en lumière les inégalités d’exposition des quartiers et de leurs différentes populations. Pour ce faire, Verdi ingénierie a notamment superposé cette carte aux données Insee. « C’est un traitement statistique assez global », prévient la chargée d’étude. Il en ressort que 27 000 Palois sur les 75 665 (ce qui représente 37 % de la population communale) vivent ainsi dans un périmètre classé rouge, soit le palier maximum en termes d’exposition.
À Pau, 22 % des bâtiments sont soumis à une forte exposition. Seuls 4 000 administrés, soit 5 %, habiteraient un secteur dit « très peu exposé ».
Le facteur de l’âge
L’analyse s’est aussi penchée sur la vulnérabilité des seniors (+ 65 ans) et des enfants de moins de 6 ans, strates de population les plus affectées par les fortes chaleurs. Au vu des données, il apparaît que les jeunes et les personnes âgées ne subissent pas « une exposition élevée » à Pau. Une situation qui s’explique aussi par la répartition géographique des crèches, des écoles primaires, des centres médicaux et des maisons de retraite. Seuls 24 d’entre eux figurent en zone très exposée. « L’âge n’est pas un facteur discriminant dans l’exposition à l’inconfort thermique, du moins sur le lieu de résidence des habitants de Pau », conclut le cabinet Verdi.
Le rôle du revenu des ménages
En revanche, les classes moyennes et populaires apparaissent comme « les plus durement exposées aux ICU tandis que les ménages les plus aisés le sont un peu moins ». « Ceux-ci pourront plus facilement entreprendre des travaux de rénovation énergétique pour mieux s’isoler de la chaleur intense », explique Clara Gerstein.
Toutefois dans la cité royale, seuls 23 % des logements sociaux de la commune sont fortement exposés. « Bien que la pauvreté des ménages puisse être un facteur discriminant face aux fortes chaleurs et au manque de végétation, les logements sociaux de Pau se trouvent dans des zones relativement peu exposées à l’inconfort thermique », souligne la chargée d’étude.
Dans la cité royale, plus d’un cinquième des bâtiments seraient soumis à une forte exposition, mettant en exergue la problématique de l’isolation. « Ceux construits avant 1945, bien qu’ils soient les moins nombreux dans la commune, sont les plus impactés », note l’étude.
| Verdi préconise la végétalisation de petits espaces Basé à Lille, le bureau d’études en aménagement urbain, Verdi ingénierie, réalise des missions en urbanisme partout en France. Il a notamment planché sur le thème des îlots de chaleur urbains dans les villes de Bordeaux, Montpellier, Vichy, Brive… À Pau, Verdi n’a pas travaillé à la demande de la municipalité. Il a réalisé un travail d’analyse dans le cadre d’une « démarche d’innovation et de prospection menée à l’échelle du Groupe » de façon à comparer les données. Après ces études, Verdi ingénierie préconise des solutions aux collectivités. Dans le cas de la cité royale, « on ne peut pas conseiller de raser la moitié du centre-ville pour aménager des parcs. Notre approche consiste plutôt à cibler des zones dans lesquelles il convient d’aménager de petits espaces végétalisés », détaille la chargée d’études Clara Gerstein. La méthode privilégie la multiplication de ces plantations de différentes strates de végétalisation, comportant de petits massifs arborés. « Ces refuges de fraîcheur jouent sur le confort thermique », poursuit l’experte. Une politique mise en œuvre depuis plusieurs années par la Ville. En complément, un traitement des sols peut également être mené en utilisant des matériaux « plus ou moins clairs » afin d’atténuer la réflexivité des rayons du soleil. |

Les Échos du Touquet | 03.08.2025
50 millions d'euros pour rénover 24 kilomètres de voirie et de trottoirs
La Ville a choisi de mettre en place un marché global de performance pour rénover 127 rues. Cela permet de tout faire sur un temps (très court) tout en remboursant sur 10 ans.
VOIR PLUS
Lors du dernier conseil municipal, le 7 juillet, l’ensemble des élus a décidé de valider le choix du groupement d’entreprises dans le cadre du Marché Global de Performance (MGP) pour rénover 24 kilomètres de voirie, trottoirs, réseaux et éclairage. Mais aussi l’assainissement, la signalisation, les espaces verts. Ce groupement, formé par les entreprises Eurovia-Ramery, Citeos, Verdi et Seve Energie est venu, lundi 28 juillet, expliquer les modalités de son contrat et la philosophie du projet.
Et c’est Gérald Dereumetz, le mandataire et chef d’agence chez Eurovia Pas-de-Calais, a présenté ceux qui, après presque 4 ans de réflexion menée par la Ville et de montages juridique et financier, œuvreront à la transformation de 127 rues de la station : « Sur un sujet où les attentes étaient très claires mais à la fois très importantes, il a fallu trouver des partenaires pour répondre à toute la diversité technique et de conception et de réalisation sur ce type de dossier. Alors je vous avouerai qu’en tant qu’entreprise locale je me suis d’abord préoccupé à trouver des locaux mais que ce type d’appel d’offres est pour nous aussi une première. Le premier besoin dans ce type de dossier ça a été d’avoir avec nous un partenaire en termes de conception. La conception c’est comment on imagine, comment on développe une prestation, une idée. Là c’est la société Verdi représentée par Nadia Ez Zafir, directrice adjointe Verdi Nord de France. En parallèle il a fallu s’associer avec des sachants en termes d’enfouissement et d’éclairage : Citéos implanté à Boulogne et la société Seve (…) On a tous des services centraux, une entreprise d’espace vert, de marquage au sol et des partenaires du deuxième rang qui nous ont accompagnés pendant ces six mois d’études. »
L’occasion aussi de projeter quelques images des rues rénovées afin de rassurer les Touquettois : l’identité de la ville est préservée, les capacités de stationnement inchangés, les trottoirs seront d’une largeur minimum d’1,40 m pour les fauteuils et les poussettes, pas de changement de sens de circulation, des pistes ou des bandes cyclables selon les rues… « On a fait de la dentelle ! » assure Nadia Ez Zafir. Mais aussi leur dire que, pour la suite, il y aura une réunion par quartier, que « les riverains auront des informations régulières par un site internet, par des mails, par des flyers. On communiquera les contraintes de circulation, les contraintes de calendrier, parce qu’il y a des moments où c’est un peu plus lourd que d’autres, lorsqu’on fait des enrobés, clairement on ne passe plus du tout. On aura une mise en place d’une ligne téléphonique pour que vous puissiez communiquer avec nous, ainsi qu’avec la commune. Et surtout ce que je tiens à dire, parce que ce métier là on le fait tous depuis de nombreuses années, un chantier se passe bien quand les riverains sont concernés, impliqués et qu’ils sont proactifs » a conclu Gérald Dereumetz.
Et c’est Gérald Dereumetz, le mandataire et chef d’agence chez Eurovia Pas-de-Calais, a présenté ceux qui, après presque 4 ans de réflexion menée par la Ville et de montages juridique et financier, œuvreront à la transformation de 127 rues de la station : « Sur un sujet où les attentes étaient très claires mais à la fois très importantes, il a fallu trouver des partenaires pour répondre à toute la diversité technique et de conception et de réalisation sur ce type de dossier. Alors je vous avouerai qu’en tant qu’entreprise locale je me suis d’abord préoccupé à trouver des locaux mais que ce type d’appel d’offres est pour nous aussi une première. Le premier besoin dans ce type de dossier ça a été d’avoir avec nous un partenaire en termes de conception. La conception c’est comment on imagine, comment on développe une prestation, une idée. Là c’est la société Verdi représentée par Nadia Ez Zafir, directrice adjointe Verdi Nord de France. En parallèle il a fallu s’associer avec des sachants en termes d’enfouissement et d’éclairage : Citéos implanté à Boulogne et la société Seve (…) On a tous des services centraux, une entreprise d’espace vert, de marquage au sol et des partenaires du deuxième rang qui nous ont accompagnés pendant ces six mois d’études. »
L’occasion aussi de projeter quelques images des rues rénovées afin de rassurer les Touquettois : l’identité de la ville est préservée, les capacités de stationnement inchangés, les trottoirs seront d’une largeur minimum d’1,40 m pour les fauteuils et les poussettes, pas de changement de sens de circulation, des pistes ou des bandes cyclables selon les rues… « On a fait de la dentelle ! » assure Nadia Ez Zafir. Mais aussi leur dire que, pour la suite, il y aura une réunion par quartier, que « les riverains auront des informations régulières par un site internet, par des mails, par des flyers. On communiquera les contraintes de circulation, les contraintes de calendrier, parce qu’il y a des moments où c’est un peu plus lourd que d’autres, lorsqu’on fait des enrobés, clairement on ne passe plus du tout. On aura une mise en place d’une ligne téléphonique pour que vous puissiez communiquer avec nous, ainsi qu’avec la commune. Et surtout ce que je tiens à dire, parce que ce métier là on le fait tous depuis de nombreuses années, un chantier se passe bien quand les riverains sont concernés, impliqués et qu’ils sont proactifs » a conclu Gérald Dereumetz.
| Calendrier et financement : comment ça va se passer ? « Il faut savoir que ce dossier a été transmis, en même temps que celui du front de mer, à Bercy et à la DGFI (direction générale des Finances publiques ndlr), qui sont deux organismes qui ont validé le montage juridique, l’autre la capacité financière de la ville. » Quand on parle de plusieurs dizaines de millions d’euros (50 millions en l’occurrence), le maire du Touquet, Daniel Fasquelle, veut être rassurant : « C’est tout à fait faisable puisqu’on a une capacité d’investissement annuelle de 10 à 12 millions d’euros, encore que cette année ce sont 14,5 que nous investissons, là-dessus nous allons investir 3,8 millions (HT ndlr) chaque année pour la rénovation de la voirie et des trottoirs, sachant que ça coûte plus cher que ça : 4,8 millions d’euros mais on est certain d’avoir 1 million d’euros de subventions. » Du côté du calendrier, deux rues test seront lancées à l’automne 2025, puis, le calendrier sera dévoilé par le groupement d’entreprises. De 2026 à 2030 : traitement des rues les plus dégradées avec, pour chaque quartier, des réunions préalables. De 2031 à 2035, on sera dans la phase complémentaire pour les rues les moins abîmées. |
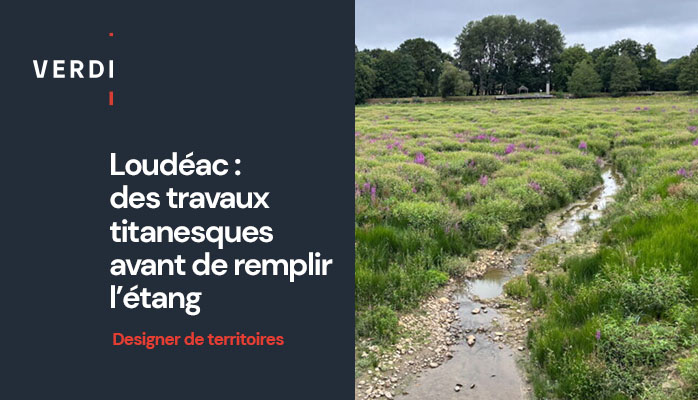
Actu.fr | 31.07.2025
Côtes-d’Armor : des travaux titanesques avant de remplir l’étang
L'étang d'Aquarev à Loudéac (Côtes-d'Armor), à sec depuis octobre 2024 va connaitre des travaux à compter de septembre 2025 avant une remise en eau est prévue en avril 2026.
VOIR PLUS
Ce que certains considèrent comme la « vitrine » de Loudéac (Côtes-d’Armor) fait l’objet d’un vaste chantier. Depuis fin octobre 2024, l’étang du parc Aquarev se retrouve à sec, volontairement. Une action réalisée par la Ville de Loudéac, avec plusieurs objectifs.
Jeudi 31 juillet 2025, on découvre les prochaines opérations programmées par la mairie, pour le remettre en état. Le tout avec une remise en eau espérée à partir de janvier 2026, pour un remplissage vers le mois d’avril 2026.
Quatre objectifs derrière ces travaux
Pour rappel, quatre objectifs reposent derrière ce chantier :
Première étape donc : « l’Égérie dense », aussi appelée « Élodée dense ». « Au fil des études, on a compris que la seule manière pour tenter d’éradiquer l’étang serait de le mettre à sec », rappelle Anthony Kérichard, responsable des services techniques de Loudéac. « Les premiers résultats semblent concluants. Avec une semaine de gel cet hiver et une fin de printemps et un début d’été sec, les vases ont bien séché. »
De quoi espérer la disparition de la plante. « Mais on dit bien qu’on devrait l’avoir éradiqué. On ne peut pas être certain à 100 % », précise Philippe Presse, élu en charge du dossier. « Cette invasion de l’étang, c’est arrivé à partir d’un morceau d’Élodée, qui se développe très vite. Les services seront très vigilants pour éviter son retour », ajoute Anthony Kérichard.
Curer, déplacer et stocker la vase
Autre « gros morceau » du dossier : gérer les milliers de m³ de vase. « Dès le départ, on savait qu’on ne pourrait pas curer entièrement l’étang. Le curage en soi demanderait un investissement financier trop important. Sans compter ensuite le coût de retraitement de la boue », rappelle Philippe Presse.

L’étang d’Aquarev à Loudéac (Côtes-d’Armor), jeudi 31 juillet 2025, neuf mois après sa mise à sec. ©Alexandre Da Silva
« Rien que de curer l’étang entièrement, sans parler du retraitement, on en aurait eu pour 1,2 million d’euros », précise le responsable des services techniques. La Ville s’en passera donc. « Mais il fallait trouver une autre solution, dans l’idée de curer en partie et réutiliser ces boues à certains endroits de l’étang », expliquent-ils. En prenant l’exemple de la commune de Bédée (Ille-et-Vilaine), la Ville compte aménager deux digues en utilisant ces boues. « Ces digues nous permettront de stocker, derrière, la vase curée dans l’étang. » Au total, le projet prévoit le curage de 10 000 m³ de vase.
La commune profitera de ces digues pour aménager deux nouveaux chemins piétons en sable chaux, sur une largeur de trois mètres, qui permettront de déambuler « sur » l’étang. Ces deux digues seront aménagées à partir de septembre 2025, zone sud, le long de la route de Rennes. Une côté camping et l’autre vers la Maison de la Pêche et de la Nature.

Côté sud du parc Aquarev à Loudéac (Côtes-d’Armor), la Ville va dessiner deux digues pour y stocker et y retenir les vases curées dans l’étang. Elle y aménagera de nouveaux chemins piétons sur ces digues. Les travaux devraient débuter en septembre 2025. ©Alexandre Da Silva
Après nivellement, le remblai en vase, retenu par les digues, sera renaturé avec un mélange de graines adapté aux berges et zones humides. De quoi créer de nouveaux espaces naturels sur environ 7 000 m². C’est l’entreprise Lessard TP qui aura en charge cette partie du chantier. Ce curage de l’étang en partie permettra à la commune d’aménager des « zones de pêche », plus profondes par exemple, en fonction des concertations avec les pêcheurs.

À gauche et à droite, les futures digues (formes arrondies) qui seront créées en curant l’étang. ©Ville de Loudéac
1 000 m³ de sédiments en plus par an
Pour terminer, et éviter de se retrouver dans la même situation dans quelques années, la commune prévoit de « filtrer » l’eau qui arrive dans l’étang d’Aquarev. « Chaque année, on a 1 000 m³ de sédiments qui arrivent dans l’étang », alerte Philippe Presse.
Le cours d’eau qu’on connaît sous le nom du Larhon en apporte une grande partie. Surtout en période de pluies quand il déborde et se déverse dans l’étang. La commune va donc aménager un « piège » pour retenir les sédiments présents dans le cours d’eau, au nord-est du plan d’eau. « Ça nous permettra de venir curer juste ce petit espace où les sédiments sont retenus, plutôt qu’ils ne terminent dans l’étang. »
Autre source d’apport de sédiments : le cours d’eau des Blinfaux, qui passe le long de l’avenue de Büdingen. La commune étant propriétaire de terrains sur cette zone, un travail de reméandrage du cours d’eau a commencé fin juillet 2025. « On vient redessiner le cours d’eau en reprenant son cours initial, pour créer de nombreux arrondis qui viennent ralentir le cours d’eau et retenir les sédiments », résume Philippe Presse.

Fin juillet 2025, des travaux de reméandrage du cours d’eau qui longe l’avenue de Büdingen à Loudéac (Côtes-d’Armor) sont en cours, pour ralentir l’eau et retenir les sédiments, et éviter qu’ils ne se déversent dans l’étang d’Aquarev. ©Alexandre Da Silva
Des travaux de terrassement pris en charge par Loudéac Communauté. « Et à l’avenir, mais sur du plus long terme, il faudra que chacun travaille en amont pour retenir et limiter encore un peu plus les sédiments. »
Près de 500 000 € de travaux
Coût total de ces opérations : 400 000 € HT, soit 480 000 € TTC. Le tout à la charge de la commune. « Il n’existe pas d’aides financières de l’Europe ou de l’État pour ce type de travaux », soulignent Philippe Presse et Anthony Kérichard. La mairie précise que « ces travaux se font en concertation avec les différents acteurs concernés ».
C’est-à-dire la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), la Fédération de pêche, la société de pêche locale, les gérants du camping, la Police de l’eau. En étant accompagnée dans les études par le Cabinet Icema, récemment racheté par l’entreprise Verdi.
Rendez-vous donc en septembre 2025…
Jeudi 31 juillet 2025, on découvre les prochaines opérations programmées par la mairie, pour le remettre en état. Le tout avec une remise en eau espérée à partir de janvier 2026, pour un remplissage vers le mois d’avril 2026.
Quatre objectifs derrière ces travaux
Pour rappel, quatre objectifs reposent derrière ce chantier :
- Tenter de supprimer la plante invasive, l’Égérie dense, qui a envahi l’étang depuis 2020-2021 ;
- Changer l’ouvrage qui permet de réguler l’eau de l’étang, largement obsolète ;
- Gérer l’envasement de l’étang ;
- Limiter l’envasement en limitant la quantité de sédiments qui arrivent à Aquarev.
Première étape donc : « l’Égérie dense », aussi appelée « Élodée dense ». « Au fil des études, on a compris que la seule manière pour tenter d’éradiquer l’étang serait de le mettre à sec », rappelle Anthony Kérichard, responsable des services techniques de Loudéac. « Les premiers résultats semblent concluants. Avec une semaine de gel cet hiver et une fin de printemps et un début d’été sec, les vases ont bien séché. »
De quoi espérer la disparition de la plante. « Mais on dit bien qu’on devrait l’avoir éradiqué. On ne peut pas être certain à 100 % », précise Philippe Presse, élu en charge du dossier. « Cette invasion de l’étang, c’est arrivé à partir d’un morceau d’Élodée, qui se développe très vite. Les services seront très vigilants pour éviter son retour », ajoute Anthony Kérichard.
| Vidanger à distance Autre étape du chantier : mettre en conformité l'organe de vidange. “ Il était plus que temps d'intervenir. Celui qu'on a est beaucoup trop vieux, et dangereux, avec un système de batardeau qu'on retire ou qu'on ajoute, à la main ”, admet Philippe Presse. Le prochain installé par le groupement Le Du Industrie de Châtelaudren et Roussel BTP de Hémon permettra de le guider à distance. Cette opération interviendra de fin septembre 2025 à janvier 2026. |
Curer, déplacer et stocker la vase
Autre « gros morceau » du dossier : gérer les milliers de m³ de vase. « Dès le départ, on savait qu’on ne pourrait pas curer entièrement l’étang. Le curage en soi demanderait un investissement financier trop important. Sans compter ensuite le coût de retraitement de la boue », rappelle Philippe Presse.

L’étang d’Aquarev à Loudéac (Côtes-d’Armor), jeudi 31 juillet 2025, neuf mois après sa mise à sec. ©Alexandre Da Silva
« Rien que de curer l’étang entièrement, sans parler du retraitement, on en aurait eu pour 1,2 million d’euros », précise le responsable des services techniques. La Ville s’en passera donc. « Mais il fallait trouver une autre solution, dans l’idée de curer en partie et réutiliser ces boues à certains endroits de l’étang », expliquent-ils. En prenant l’exemple de la commune de Bédée (Ille-et-Vilaine), la Ville compte aménager deux digues en utilisant ces boues. « Ces digues nous permettront de stocker, derrière, la vase curée dans l’étang. » Au total, le projet prévoit le curage de 10 000 m³ de vase.
La commune profitera de ces digues pour aménager deux nouveaux chemins piétons en sable chaux, sur une largeur de trois mètres, qui permettront de déambuler « sur » l’étang. Ces deux digues seront aménagées à partir de septembre 2025, zone sud, le long de la route de Rennes. Une côté camping et l’autre vers la Maison de la Pêche et de la Nature.

Côté sud du parc Aquarev à Loudéac (Côtes-d’Armor), la Ville va dessiner deux digues pour y stocker et y retenir les vases curées dans l’étang. Elle y aménagera de nouveaux chemins piétons sur ces digues. Les travaux devraient débuter en septembre 2025. ©Alexandre Da Silva
Après nivellement, le remblai en vase, retenu par les digues, sera renaturé avec un mélange de graines adapté aux berges et zones humides. De quoi créer de nouveaux espaces naturels sur environ 7 000 m². C’est l’entreprise Lessard TP qui aura en charge cette partie du chantier. Ce curage de l’étang en partie permettra à la commune d’aménager des « zones de pêche », plus profondes par exemple, en fonction des concertations avec les pêcheurs.

À gauche et à droite, les futures digues (formes arrondies) qui seront créées en curant l’étang. ©Ville de Loudéac
1 000 m³ de sédiments en plus par an
Pour terminer, et éviter de se retrouver dans la même situation dans quelques années, la commune prévoit de « filtrer » l’eau qui arrive dans l’étang d’Aquarev. « Chaque année, on a 1 000 m³ de sédiments qui arrivent dans l’étang », alerte Philippe Presse.
Le cours d’eau qu’on connaît sous le nom du Larhon en apporte une grande partie. Surtout en période de pluies quand il déborde et se déverse dans l’étang. La commune va donc aménager un « piège » pour retenir les sédiments présents dans le cours d’eau, au nord-est du plan d’eau. « Ça nous permettra de venir curer juste ce petit espace où les sédiments sont retenus, plutôt qu’ils ne terminent dans l’étang. »
Autre source d’apport de sédiments : le cours d’eau des Blinfaux, qui passe le long de l’avenue de Büdingen. La commune étant propriétaire de terrains sur cette zone, un travail de reméandrage du cours d’eau a commencé fin juillet 2025. « On vient redessiner le cours d’eau en reprenant son cours initial, pour créer de nombreux arrondis qui viennent ralentir le cours d’eau et retenir les sédiments », résume Philippe Presse.

Fin juillet 2025, des travaux de reméandrage du cours d’eau qui longe l’avenue de Büdingen à Loudéac (Côtes-d’Armor) sont en cours, pour ralentir l’eau et retenir les sédiments, et éviter qu’ils ne se déversent dans l’étang d’Aquarev. ©Alexandre Da Silva
Des travaux de terrassement pris en charge par Loudéac Communauté. « Et à l’avenir, mais sur du plus long terme, il faudra que chacun travaille en amont pour retenir et limiter encore un peu plus les sédiments. »
Près de 500 000 € de travaux
Coût total de ces opérations : 400 000 € HT, soit 480 000 € TTC. Le tout à la charge de la commune. « Il n’existe pas d’aides financières de l’Europe ou de l’État pour ce type de travaux », soulignent Philippe Presse et Anthony Kérichard. La mairie précise que « ces travaux se font en concertation avec les différents acteurs concernés ».
C’est-à-dire la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), la Fédération de pêche, la société de pêche locale, les gérants du camping, la Police de l’eau. En étant accompagnée dans les études par le Cabinet Icema, récemment racheté par l’entreprise Verdi.
Rendez-vous donc en septembre 2025…
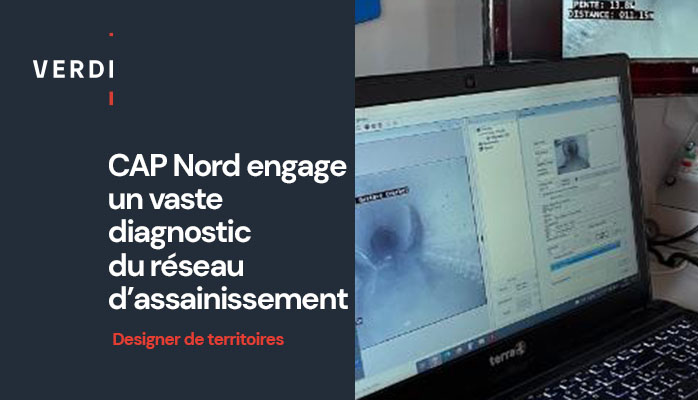
Cap Nord actualités | 30.07.2025
CAP Nord engage un vaste diagnostic du réseau d'assainissement
Dans le cadre de sa compétence en matière d'assainissement collectif des eaux usées, CAP Nord Martinique, en partenariat avec la Ville du Robert, engage à compter du lundi 4 août 2025 une opération de diagnostic technique des réseaux d'assainissement.
VOIR PLUS
Ces investigations, qui s’échelonneront sur une durée de 6 mois, visent à améliorer durablement le fonctionnement du système de collecte des eaux usées. Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, ce diagnostic permettra d’identifier les éventuels dysfonctionnements du réseau, d’optimiser son rendement et de limiter les nuisances pour les usagers.

Nettoyage sous pression des canalisations.
Les travaux seront réalisés par des entreprises spécialisées mandatées par CAP Nord Martinique : VERDI, SEA, ORIAD, SOMANET et ELITE ASSAINISSEMENT.
Quelles interventions seront réalisées ?
Plusieurs opérations techniques sont programmées :
Analyse vidéo pour repérer fissures, obstructions ou anomalies.
Ces actions permettront de prévenir les engorgements, réduire les nuisances et assurer un meilleur traitement des eaux usées. Les interventions seront réalisées de manière sectorisée dans les quartiers Courbaril, Moulin à Vent et Pointe Lynch.

Injection de fumée non toxique pour localiser les infiltrations d’eaux parasites.
Des panneaux d’information seront installés et les riverains seront informés à l’avance, notamment avant les tests à la fumée. Ces investigations s’inscrivent pleinement dans la stratégie de CAP Nord Martinique pour améliorer la qualité du service public d’assainissement, préserver l’environnement et garantir un meilleur cadre de vie aux habitants.

Nettoyage sous pression des canalisations.
Les travaux seront réalisés par des entreprises spécialisées mandatées par CAP Nord Martinique : VERDI, SEA, ORIAD, SOMANET et ELITE ASSAINISSEMENT.
Quelles interventions seront réalisées ?
Plusieurs opérations techniques sont programmées :
- Hydrocurage : nettoyage sous pression des canalisations pour éliminer les dépôts ;
- Inspection par caméra : analyse vidéo pour repérer fissures, obstructions ou anomalies ;
- Tests à la fumée : injection de fumée non toxique pour localiser les infiltrations d’eaux parasites ;
- Tests au colorant : vérification des raccordements au réseau chez certains abonnés.

Analyse vidéo pour repérer fissures, obstructions ou anomalies.
Ces actions permettront de prévenir les engorgements, réduire les nuisances et assurer un meilleur traitement des eaux usées. Les interventions seront réalisées de manière sectorisée dans les quartiers Courbaril, Moulin à Vent et Pointe Lynch.

Injection de fumée non toxique pour localiser les infiltrations d’eaux parasites.
Des panneaux d’information seront installés et les riverains seront informés à l’avance, notamment avant les tests à la fumée. Ces investigations s’inscrivent pleinement dans la stratégie de CAP Nord Martinique pour améliorer la qualité du service public d’assainissement, préserver l’environnement et garantir un meilleur cadre de vie aux habitants.


 Designer de territoires
Designer de territoires Suivez-nous sur Linkedin
Suivez-nous sur Linkedin